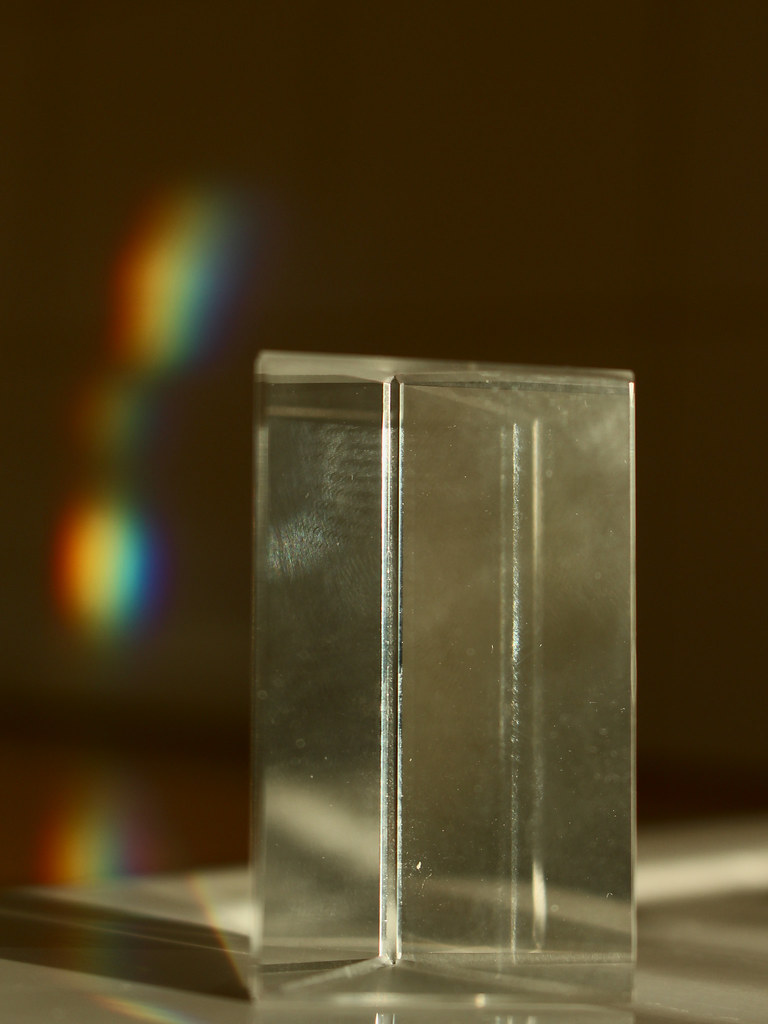L’histoire de la physique au Canada comprend le développement des études de premier cycle, des études supérieures et de la recherche dans les universités, ainsi que la recherche dans les institutions gouvernementales et l’industrie privée.
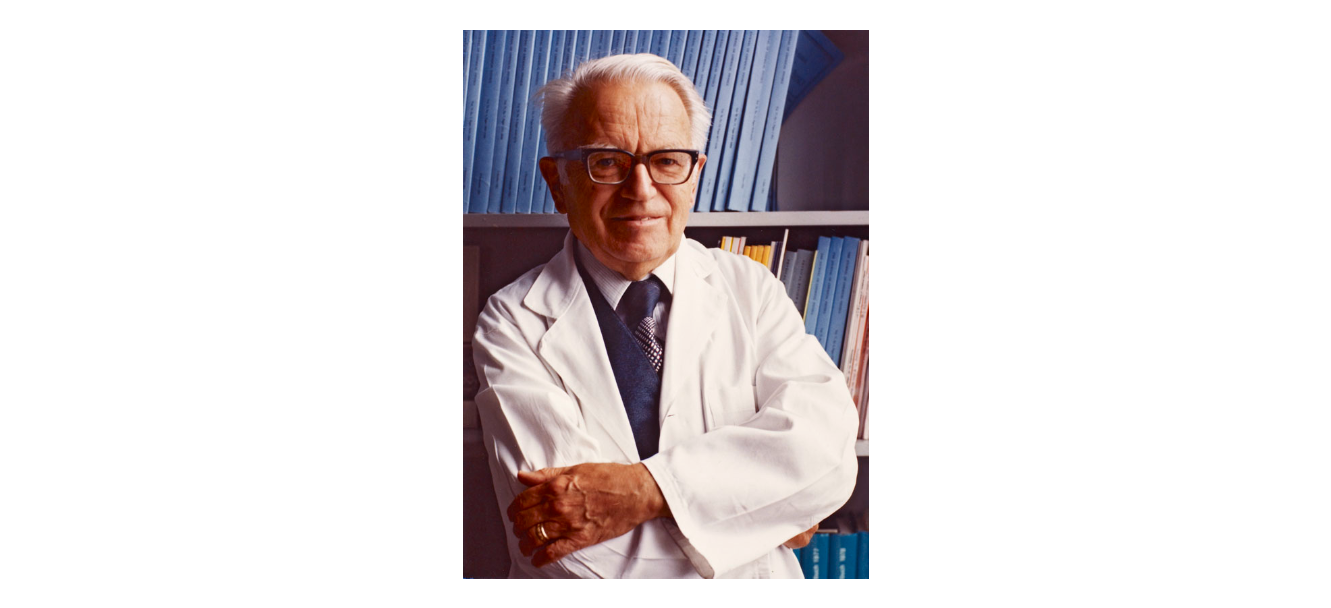
Universités
Les premiers professeurs de philosophie naturelle (la physique associée aux mathématiques) sont nommés à l’Université Dalhousie en 1838 et au King’s College (qui devient plus tard l’Université de Toronto) en 1843. Des postes de professeurs sont créés à l’Université Dalhousie (1879), à l’Université de Toronto (1887) et à l’Université McGill (1890). Les professeurs se consacrent principalement à l’enseignement et n’entreprennent que peu de recherches originales. Toutefois, les découvertes en Europe dans les années 1890 (rayons X, radioactivité, électrons et autres) incitent les professeurs canadiens à devenir actifs dans le développement de leur discipline. Ernest Rutherford (de l’Université McGill) et sir John Cunningham McLennan (de l’Université de Toronto) se distinguent particulièrement. La mise en place de programmes d’études supérieures et de recherche s’ensuit.
Jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, l’Université de Toronto et l’Université McGill sont les seules universités canadiennes qui décernent des doctorats en physique. Toutefois, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs universités mettent sur pied des programmes complets d’études supérieures et de recherche. Entre 1974 et 1985, 1075 doctorats en physique sont décernés par 28 universités (dont 31 % à l’Université de Toronto.
La lenteur des débuts de la recherche en physique s’explique en grande partie par des difficultés financières. La fondation en 1916 du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) stimule le développement de la science grâce à des bourses d’études pour les étudiants de troisième cycle et à des subventions aux professeurs. L’aide financière des gouvernements fédéral et provinciaux augmente, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. En 1980, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (fondé en 1978) remplace le CNRC en tant que principal organisme subventionnaire fédéral.
L’Université Dalhousie peut probablement revendiquer la première recherche significative effectuée par un professeur de physique. James Gordon MacGregor est nommé en 1879 et, au cours des 20 années qui suivent, il publie quelque 50 articles et mémoires. H.L. Bronson, directeur du département de 1910 à 1956, inspire de nombreux étudiants à choisir une carrière en physique, comme G.H. Henderson (radioactivité, halos pléochroïques) et W.J. Archibald (physique théorique).
L’Université McGill connait un excellent départ avec H.L. Callendar et Ernest Rutherford comme professeurs de physique à la chaire Macdonald. Ernest Rutherford y réalise d’importantes découvertes en radioactivité et en physique nucléaire, aidé de nombreux assistants parmi lesquels certains (par exemple Henri Marshall Tory, J.A. Gray, H.L. Bronson, Robert William Boyle) jouent un rôle primordial dans le progrès de la science dans d’autres régions du pays. La physique nucléaire à l’Université McGill culmine en 1949 avec la fondation du Radiation Laboratory, doté du premier cyclotron au Canada. Ce développement est principalement dû à John Stuart Foster, reconnu mondialement pour ses travaux sur l’effet Stark. Le Radiation Laboratory est sous la direction de R.E. Bell pendant de nombreuses années, et J.M. Robson, spécialiste en physique nucléaire, est directeur du département de physique. Dans les années 1920, L.V. King réalise d’importants travaux en physique mathématique. David Arnold Keys et A.S. Eve sont à l’origine des premiers travaux en géophysique et, un peu plus tard, il en va de même pour J.S. Marshall en physique de l’atmosphère. L’Université McGill est la première université canadienne à développer un groupe de physique théorique et elle forme de nombreux théoriciens de réputation internationale.
J.C. McLennan est directeur du laboratoire de physique à l’Université de Toronto, de 1906 à 1932. Ses premières recherches portent sur la conductivité atmosphérique et les rayons cathodiques, mais il passe ensuite à la spectroscopie atomique avec l’avènement de l’atome de Bohr en 1912. Des membres du département, soit M.F. Crawford, H.L. Welsh, Elizabeth J. Allin et, depuis 1965, Boris Peter Stoicheff, chef d’un grand laboratoire équipé de lasers, portent un intérêt soutenu à l’optique et à la spectroscopie. Dans les années 1920, J.C. McLennan, Gordon Merritt Shrum et d’autres construisent un liquéfacteur d’hélium, le premier en Amérique du Nord, pour effectuer des travaux sur les métaux et les gaz solidifiés à basse température. Ce type de travail se poursuit encore activement. Au cours de cette période initiale, Eli Franklin Burton supervise les recherches en physique des colloïdes et, à la fin des années 1930, il construit avec ses étudiants le premier microscope électronique à haute résolution en Amérique du Nord.
À la fin des années 1920, L. Gilchrist entreprend des travaux en géophysique, et plus tard, sous la direction de John Tuzo Wilson, ils deviennent l’un des plus grands groupes de recherche du département. Dans les années 1960, un programme en physique atmosphérique est inauguré. Au début des années 1960, K.G. McNeill et Albert Edward Litherland entament des travaux approfondis en physique des particules de haute énergie, ainsi que Harold Elford Johns en biophysique médicale. Jusque dans les années 1960, la physique théorique est principalement l’affaire du département de mathématiques appliquées, qui comprend J.L. Synge et L. Infeld. Cependant, en 1958, J. Van Kranendonk est nommé, et une importante section théorique, incluant la plupart des branches de la physique moderne, est mise sur pied au département de physique.
L’Université de la Colombie-Britannique et l’Université McMaster, fondées au tournant du siècle, effectuent des progrès remarquables dans leur productivité scientifique au cours des années 1940. À l’Université de la Colombie-Britannique, le changement est dû à la nomination de G.M. Shrum (directeur de 1938 à 1961) et d’autres (dont G.M. Volkoff, M. Bloom, R.D. Russell et J.B. Warren), qui rendent possible un large éventail d’enseignement et de recherches dans plusieurs branches de la physique. Dans les années 1970, l’Université de la Colombie-Britannique devient le site de TRIUMF (Tri-University Meson Facility), l’une des installations nucléaires les plus importantes au Canada. L’Université McMaster devient un important centre scientifique canadien à la suite de la nomination de Henry George Thode en 1939. Ses travaux sur la spectroscopie de masse et les abondances isotopiques mènent M.W. Johns, H.E. Duckworth, Bertram Neville Brockhouse et d’autres à travailler intensivement sur divers aspects de la physique nucléaire. En 1957, un réacteur de recherche est installé, le premier réacteur universitaire du Commonwealth, suivi dans les années 1970 d’un laboratoire d’accélérateur de particules doté d’installations complètes. L’Université McMaster se distingue dans d’autres secteurs de recherche comme la spectroscopie (A.B. McLay), la physique de l’état solide, la biophysique et la physique théorique (M.H. Preston, J. Carbotte). La recherche est interdisciplinaire (par exemple au Institute for Materials Research avec J.A. Morrison comme directeur).
R.W. Boyle devient professeur de physique à l’Université de l’Alberta en 1912 et il commence des recherches approfondies en ultracoustique. Un peu plus tard, S. Smith et R.J. Lang entreprennent d’importants travaux en optique et en spectroscopie. La recherche s’élargit progressivement à la géophysique (J.A. Jacobs) et à la physique de l’état solide, à la physique nucléaire, à la physique médicale et à la physique théorique (A.B. Bhatia, Werner Israel).
À l’Université Laval, le physicien italien F. Rasetti ouvre la voie à une nouvelle ère dans l’enseignement et la recherche en physique (1939-1947). Il est suivi par son ami E. Persico (1947-1950) et par John Larkin Kerwin, par P. Marmet, A. Boivin et d’autres. Les principaux domaines de recherche sont l’optique, la physique atomique et moléculaire, la physique nucléaire et la physique théorique. Comme à l’Université Laval, l’Université de Montréal accroit considérablement ses contributions à la physique canadienne au cours des 30 dernières années. Les deux principaux domaines de recherche sont la physique nucléaire et la physique des plasmas, ainsi que la théorie qui leur est associée, développés par P. Demers et P. Lorrain.
Le département de l’Université du Manitoba commence ses activités grâce à F. Allen, qui applique la physique à la physiologie. Après la Deuxième Guerre mondiale, R.W. Pringle entreprend activement des travaux en physique nucléaire qui sont rapidement développés par B.G. Hogg et d’autres. Plus tard, A.H. Morrish entreprend des travaux importants sur les matériaux magnétiques. Le département de l’Université de la Saskatchewan se développe pendant la longue période de direction (1924-1956) de E.L. Harrington. Les recherches sur la haute atmosphère, amorcées par B.W. Currie en 1932, aboutissent à la création de l’actuel Institute of Space and Atmospheric Studies de réputation internationale. Entre 1935 et 1945, Gerhard Herzberg travaille sur les structures atomiques et moléculaires. Dans les années 1950, le département acquiert une renommée grâce à son bêtatron utilisé en physique photonucléaire et en radiothérapie, et au développement d’un appareil au cobalt 60 par Harold Elford Johns et d’autres. La physique des plasmas constitue également un domaine de recherche important. Les jeunes universités de l’Ouest, soit l’Université de Victoria, l’Université Simon Fraser et l’Université de Calgary, possèdent des départements de physique qui se développent rapidement.
L’Université Queen’s à Kingston, et l’Université Western (anciennement nommée Université Western Ontario) apportent des contributions remarquables à la physique. Dans les années 1920, A.L. Clark est à l’origine de la recherche et des études supérieures à l’Université Queen’s. J.A. Gray amorce la recherche en physique nucléaire, suivi par B.W. Sargent, A.T. Stewart et d’autres. Les autres domaines de recherches comprennent l’optique (dont l’étude est amorcée très tôt par J.K. Robertson), la spectroscopie des hyperfréquences et la physique de l’état solide. À l’Université Western, le développement de recherche progresse rapidement à partir des années 1940 grâce à un programme de radar. Le travail amorcé par R.C. Dearle, G.A. Woonton et d’autres est poursuivi par P.A. Forsyth et aboutit à la création du Centre for Radio Science (1967), où sont étudiés les problèmes de la physique de l’atmosphère et de l’ionosphère. La recherche nucléaire connait des progrès considérables, notamment dans le domaine de la diffusion des positrons (J.W. McGowan).
L’Université de Waterloo est fondée à la fin des années 1950. Le département de physique se lance immédiatement dans un programme de recherches en physique expérimentale et théorique de l’état solide ainsi que dans les domaines connexes de la physique du laser et la spectroscopie des hyperfréquences. La géophysique et la biophysique sont également étudiées. L’Université York possède le Centre for Research in Experimental Space Science dont R.W. Nicholls est le directeur fondateur. Les Universités d’Ottawa, de Winsor, de Guelph et Carleton (avec son programme de physique des particules lancé par E.P. Hincks) ont un avenir prometteur. L’Université Concordia, l’École Polytechnique de Montréal, l’Université de Sherbrooke, l’Université du Nouveau-Brunswick, l’ Université St. Francis Xavier et la Memorial University of Newfoundland mènent des études avancées en physique.
Les membres du personnel et les diplômés des départements de physique jouent un rôle important au cours des deux guerres mondiales. Pendant la Première Guerre mondiale, J.C. McLennan devient directeur de la recherche expérimentale pour l’Amirauté britannique et il organise également la production d’hélium à partir de puits canadiens de gaz naturel. R.W. Boyle mène des expériences sur les ultrasons dans la division anti-sous-marine de l’Amirauté. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le personnel des universités fait face au danger de se voir complètement épuisé en raison des demandes d’aide de la part du CNRC et d’autres organismes du gouvernement ou de la défense nationale. De plus, plusieurs universités donnent des cours intensifs en physique et en électronique au personnel enrôlé destiné à faire fonctionner les radars et les dispositifs de signalisation dans l’armée, la marine et l’armée de l’air.
Organismes fédéraux de recherche
Le CNRC joue un rôle primordial dans la recherche en physique. En 1928, il ouvre des laboratoires à Ottawa, dont la Division de physique, avec R.W. Boyle en tant que directeur. La division prend de l’expansion très rapidement après le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale; les domaines d’études importants pour l’effort de guerre comprennent la physique nucléaire, les appareils de détection de sous-marins et de déminage, la photographie aérienne et les télémètres. Afin de mettre en application les résultats obtenus en optique et en techniques radar, la Research Enterprises Limited est créée sous forme de société d’État.
Une grande partie du personnel en physique est dispersé à la fin de la guerre; toutefois, les choses commencent à s’améliorer avec la nomination de Gerhard Herzberg en 1948 et l’introduction d’un programme de coopération postdoctorale pour des périodes d’un ou deux ans en 1949. La physique appliquée devient une division séparée (1955) sous la direction de L.E. Howlett. La section de spectroscopie de la division de physique pure atteint rapidement une renommée mondiale grâce aux travaux de Gerhard Herzberg, d’A.E. Douglas, de D.A. Ramsay, de T. Oka et d’autres.
Dans les années 1970, la section de spectroscopie est incorporée à l’astronomie et à l’astrophysique à l’Institut Herzberg d’astrophysique. La section de physique de l’état solide sous la direction de D.K.C. MacDonald (1951-1963) acquiert également une renommée. Après la fondation de l’Institut Herzberg, les divisions de physique et de physique appliquée sont réunies. Cette nouvelle division comprend différentes sections : étalons électromagnétiques et étalons temporels, physique des hautes énergies et science de l’état solide.
En 1942, un projet d’énergie atomique canado-britannique, administré par le CNRC, est entrepris à Montréal et mène à la construction du NRX, un réacteur de recherche à eau lourde fonctionnant à l’uranium mis en exploitation en 1947 à Chalk River (aujourd’hui Laurentian Hills) en Ontario. En 1952, l’administration du projet est transférée à Énergie atomique du Canada Limitée. En 1957, un réacteur beaucoup plus gros, le NRU, entre en service, et un accélérateur Van de Graaff MP de type tandem est installé. L’objectif de ce programme est de développer des réacteurs de recherches pour des expérimentations nucléaires et des réacteurs nucléaires pour la production d’électricité. Wilfrid Bennett Lewis est responsable de la recherche. De nombreux physiciens canadiens participent au projet, dont G.C. Laurence, B.W. Sargent, J.M. Robson (désintégration neutronique), R.E. Bell, B.N. Brockhouse (diffusion des neutrons), E.P. Hincks (rayons cosmiques) et A.E. Litherland.
Organismes provinciaux de recherche
La recherche liée à la physique est menée par huit organismes de recherche provinciaux, le Alberta Research Council (fondé en 1921) étant le plus ancien d’entre eux. Les sociétés hydroélectriques de la plupart des provinces, dont la plus grande est Hydro-Québec, disposent d’installations de recherche relatives à la production d’électricité et son transport. (Voir aussi Hydroélectricité au Canada.)
Recherche industrielle
Comparativement à d’autres pays industrialisés, le Canada affiche un niveau de recherche et développement industriels plutôt faible. Un grand nombre des meilleurs laboratoires industriels effectuant des recherches liées à la physique sont créés en tant que filiales canadiennes de compagnies américaines. Par exemple, la Radio Corporation of America soutient pendant de nombreuses années les RCA Canadian Research and Development Laboratories Ltd (sous la direction de M.B. Bachynski à partir de 1958); en 1976, une grande partie de ses travaux est reprise par MPB Technologies Inc, avec M.B. Bachynski comme président-directeur général. Le Xerox Research Center of Canada Ltd est un exemple récent d’une compagnie américaine qui localise une partie de ses recherches au Canada. La compagnie Bell-Northern Research Ltd fait un excellent travail.

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom