Le terrorisme est le recours à la violence ou aux menaces par des personnes ou des groupes contre des civils ou des biens. Les terroristes utilisent la violence pour tenter d’atteindre des objectifs politiques. Les activités terroristes comprennent des assassinats, des attentats à la bombe, des détournements d’avion et des enlèvements. Certains États ont recours à la terreur contre leur propre population ou celles de leurs ennemis. Mais ces actes ne sont pas reconnus comme des actes terroristes en vertu du droit canadien ou international. Le mot « terroriste » est un terme politiquement chargé qui a une connotation hautement négative. Peu d’extrémistes violents accepteraient cette étiquette. Au lieu, la plupart d’entre eux se décrivent comme des combattants pour la liberté et la justice.
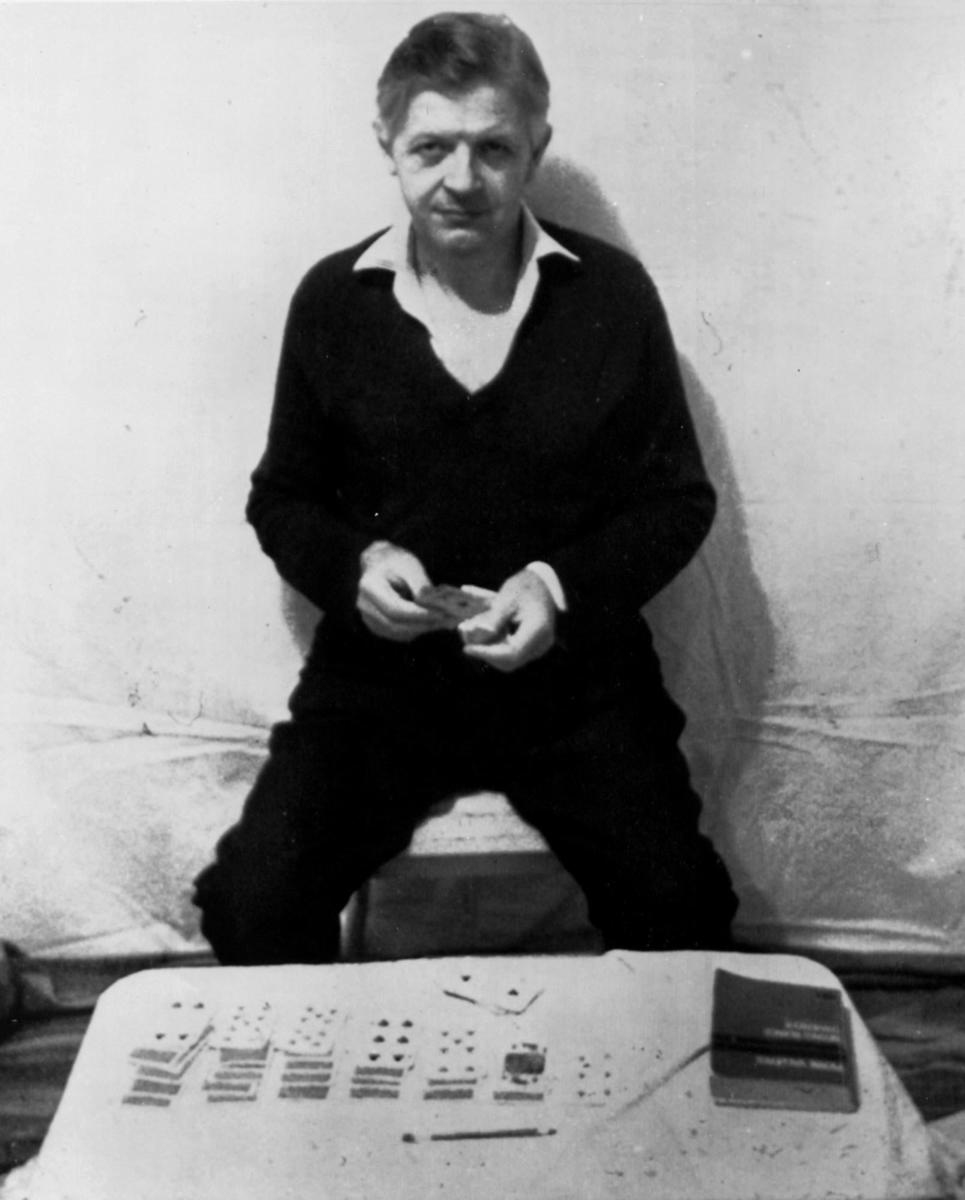
Contexte historique
Le terrorisme a de profondes racines. Des chercheurs relèvent des exemples de terrorisme au Moyen-Orient dans l’Antiquité et au Moyen Âge. Les attentats terroristes sont fréquents depuis la fin du 19e siècle. De 1880 à 1910, des anarchistes assassinent plusieurs dirigeants mondiaux. Parmi ceux-ci se trouvent le président William McKinley et le roi d’Italie Umberto 1er. En 1893, des anarchistes font exploser une bombe au Teatro Liceo de Barcelone, tuant 22 personnes et faisant 50 blessés. En 1914, un groupe nationaliste en Bosnie assassine l’héritier du trône austro-hongrois et son épouse. Cet événement déclenche une série d’événements qui mènent à la Première Guerre mondiale. Depuis, le terrorisme est utilisé par des groupes religieux, nationalistes et idéologiques, à la fois de droite comme de gauche.
Le Canada a un passé historique relativement paisible. Mais, il n’est pas immunisé contre le terrorisme. Les Canadiens sont victimes de centaines d’actes terroristes. Alors qu’ils sont au Canada, des groupes terroristes étrangers recueillent des fonds, planifient des opérations et lancent des attaques. Des citoyens canadiens commettent également des actes terroristes à l’étranger. Malgré les centaines d’attaques perpétrées par ou contre des Canadiens, le terrorisme fait rarement avancer la cause de ceux qui y ont recours.
Terrorisme au Canada
Les doukhobors de la liberté
En 1923, les Fils de la liberté lancent ce qui est probablement la première campagne terroriste au Canada. Résidents de la Colombie-Britannique, les Fils de la liberté sont un groupe radical issu des doukhobors, une secte religieuse qui rejette l’autorité de l’État. Les doukhobors orthodoxes sont des pacifistes. Mais les Fils de la liberté ont recours à la violence pour protester contre l’ingérence du gouvernement dans leur vie. Ils s’opposent à la scolarité obligatoire et à l’enregistrement obligatoire des naissances, des décès, des mariages et de la propriété foncière. Les Fils de la liberté terroristes bombardent ou incendient des écoles, des maisons, des commerces, des lignes de chemin de fer et des lignes électriques. Les doukhobors que les fanatiques jugent trop matérialistes font également partie de leurs cibles. Pendant 40 ans, les Fils de la liberté se livrent à des centaines d’attaques contre le gouvernement, les sociétés de chemin de fer et les compagnies d’électricité. L’incident le plus dramatique est l’attaque à la bombe d’un pylône électrique dans le sud-est de la Colombie-Britannique en 1962. Cette même année, 36 Fils de la liberté sont reconnus coupables d’incendie criminel ou de complot en vue de commettre un incendie criminel, et ils sont condamnés à douze ans de prison. Dans les années 1970 et au début des années 1980, les Fils de la liberté ne commettent que quelques attaques isolées.
Front de libération du Québec (FLQ)
Environ 300 actes terroristes sont commis en sol canadien dans les années 1960. Presque tous sont perpétrés par le Front de libération du Québec (FLQ). Afin d’atteindre son objectif d’un Québec indépendant, le FLQ commet une série d’attentats à la bombe contre diverses cibles. Celles-ci comprennent le gouvernement fédéral, la Société canadienne des postes, les Forces armées canadiennes, la GRC, Radio-Canada/CBC, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, et la Bourse de Montréal. Leur intention est généralement de détruire des biens. Mais au moins six personnes perdent la vie à la suite des actions du FLQ. De nombreuses autres personnes sont gravement blessées.
En octobre 1970, le FLQ enlève James Cross, diplomate britannique à Montréal, et Pierre Laporte, le ministre du Travail du Québec. Le gouvernement du Québec demande l’aide de l’armée canadienne pour gérer ce qui devient éventuellement connu sous le nom de la crise d’octobre. Le premier ministre Pierre Elliott Trudeau invoque la Loi sur les mesures de guerre et il suspend les libertés civiles. Ceci permet à la police d’arrêter des centaines de personnes sans inculpation. Pierre Laporte est étranglé à mort et ses ravisseurs sont éventuellement condamnés pour meurtre et enlèvement. Les individus qui détenaient James Cross sont envoyés par avion à Cuba en échange de sa libération. Au cours des deux années qui suivent ces événements, les activités du FLQ prennent fin. Cependant, d’autres utilisent le nom du groupe lorsqu’ils mènent des attaques au cours des années 1970 et 1980.
Direct Action
Au début des années 1980, Direct Action, un petit groupe anarchiste, lance une violente campagne contre la pollution, la pornographie et l’industrie de l’armement. Les activités du groupe sont financées par la fraude et le vol à main armée. Ses cibles comprennent une sous-station électrique de BC Hydro sur l’île de Vancouver et l’usine de Litton Systems de Toronto, qui fabrique des composants de missiles de croisière. Quelques membres du groupe, agissant sous le nom de Wimmin’s Fire Brigade, incendient à la bombe trois clubs vidéo pour adultes dans la région du Grand Vancouver. Au total, Direct Action cause plus de 10 millions de dollars de dommages et fait dix blessés. Les actions du groupe cessent lorsque cinq des membres principaux (connus sous le nom de Squamish Five) sont arrêtés en janvier 1983. Ils plaident coupables et sont condamnés à des peines d’emprisonnement qui varient entre quatre et huit ans.
Terrorisme écologique
Dans les années 1980 et 1990, des extrémistes issus de mouvements pour la défense des droits des animaux et la protection de l’environnement commettent plusieurs actes de terrorisme au Canada. La branche canadienne du Front de libération des animaux libère des animaux de plusieurs laboratoires de recherche. Ils vandalisent ensuite les installations et les incendient. Un groupe se faisant appeler « the Justice Department » envoie des menaces de mort par la poste à des guides de chasse ou à des détaillants de fourrures. Ils envoient également des lames de rasoir couvertes de poison à rats ou de sang que le groupe prétend être infecté par le VIH. En 1995, des terroristes écologiques détruisent un pont forestier de 2 millions de dollars en Colombie-Britannique. Ils causent également 5 millions de dollars de dommages à une installation forestière en Alberta en 1997.
Terrorisme international au Canada
La majorité des actes terroristes perpétrés au Canada sont commis par des Canadiens dans le but d’atteindre des objectifs nationaux. Mais plusieurs incidents de nature internationale surviennent également en sol canadien.
Les raids des fenians
Les premiers incidents terroristes internationaux au Canada remontent aux fenians, dans les jours précédant la Confédération. Les fenians sont un groupe nationaliste irlandais créé en 1850. Leur objectif est d’utiliser la force pour faire avancer la cause de l’indépendance de l’Irlande face à la Grande-Bretagne. Après la fin de la guerre de Sécession en 1865, la branche des fenians des États-Unis se gonfle avec un afflux d’anciens combattants. Les membres sont divisés sur les tactiques à utiliser. Certains soutiennent les assassinats et autres activités terroristes. D’autres estiment que le groupe devrait agir comme une force militaire et s’engager dans des combats conventionnels contre l’armée canadienne ou britannique.
En 1866, les fenians lancent une série de raids infructueux au Nouveau-Brunswick, dans le Canada-Est et dans le Canada-Ouest. (Voir aussi Raids des fenians.) Ils détruisent des ponts, coupent des fils télégraphiques, endommagent ou volent des biens privés et engagent le combat avec les milices locales. Ces incidents ne font que renforcer le soutien public envers la Confédération, qui offre aux colonies une plus grande sécurité. En 1868, Thomas D’Arcy McGee, un député et un père de la Confédération, est assassiné. Le tueur est très probablement un fenian agissant sans l’approbation de sa confrérie. Les attaques des fenians qui suivent sont infructueuses. Une invasion du Québec en 1870 est repoussée. En 1871, les fenians ratent leur dernier raid au Manitoba.
Terrorisme contemporain
Le nombre d’incidents liés au terrorisme international commence à augmenter au Canada dans les années 1960. Des groupes terroristes internationaux recrutent des membres, distribuent de la propagande et falsifient des documents sur le sol canadien. Ils utilisent également le Canada comme base pour amasser des fonds, solliciter des dons et commettre des vols et des fraudes afin de financer leurs activités.
De 1960 à 1980, une soixantaine d’actes terroristes internationaux sont commis en sol canadien. En 1965, un groupe qui proteste contre la guerre du Vietnam fait exploser à la dynamite trois jets de la US Air Force au Edmonton Industrial Airport. Deux avions sont détruits et un garde de sécurité est tué. En 1968, à Toronto et à Sarnia, des activistes anti-guerre bombardent des maisons appartenant à des dirigeants d’entreprises qui fournissent des armes et d’autres matériels de guerre à l’armée américaine. Dans les années 1960, des extrémistes croates commettent des attentats à la bombe contre l’ambassade de Yougoslavie à Ottawa ainsi que contre ses consulats à Toronto et à Montréal. Entre 1966 et 1980, des Cubains anti-Castro bombardent à plusieurs reprises les missions diplomatiques de leur pays qui sont situées au Canada, tuant une personne en 1972. Des lettres piégées sont envoyées à l’ambassade d’Israël à Ottawa et à son consulat à Montréal en 1972. Dans les années 1980, des terroristes arméniens tirent sur deux diplomates turques; l’un est tué et l’autre reste paralysé. Les mêmes terroristes prennent en otage l’ambassadeur de Turquie, tuant un garde canadien au cours de l’opération. En 1986, des extrémistes sikhs blessent par balle un ministre de l’État indien du Punjab qui est en visite sur l’île de Vancouver.
Le Canada et le séparatisme sikh en Inde
L’attaque qui est de loin la plus meurtrière de cette période est l’attentat à la bombe contre un vol d’Air India, en 1985. Des extrémistes sikhs de la Colombie-Britannique, qui cherchent à créer une patrie sikhe indépendante dans la province indienne du Punjab, placent des valises piégées à la bombe dans deux avions commerciaux. Une des bombes explose au sol pendant le transfert des bagages à l’aéroport de Narita près de Tokyo, tuant deux personnes et en blessant quatre autres. L’autre bombe explose alors que le vol 182 d’Air India se trouve au large de la côte de l’Irlande. Elle tue les 329 passagers, ce qui en fait l’attentat terroriste le plus meurtrier que le monde ait connu avant celui du 11 septembre 2001. Trois conspirateurs sont inculpés. Un seul d’entre eux est condamné.
En 2006, le gouvernement fédéral nomme une commission d’enquête chargée d’enquêter sur l’attentat et de formuler des recommandations pour l’amélioration des efforts antiterroristes au Canada. En juin 2010, la commission publie un rapport de 4000 pages en cinq volumes contenant 64 recommandations. Le rapport fait appel au conseiller à la sécurité nationale du gouvernement fédéral pour assurer la coopération entre les organismes d’application de la loi. Il demande également la nomination d’un directeur national des poursuites antiterroristes, d’un nouveau coordonnateur de la protection des témoins dans les affaires de terrorisme, ainsi que des changements radicaux pour combler les lacunes en matière de sécurité aéroportuaire.
En septembre 2023, un incident international majeur se produit lorsque le premier ministre Justin Trudeau accuse des « agents du gouvernement indien » d’avoir assassiné l’activiste sikh et citoyen canadien Hardeep Singh Nijjar devant un temple sikh à Surrey en Colombie-Britannique, en juin 2023. Lors d’un discours à la Chambre des communes, Justin Trudeau déclare : « Toute implication d’un gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien en sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté… Comme vous pouvez l’imaginer, nous travaillons en étroite collaboration et en coordination avec nos alliés sur cette affaire très grave. » Deux jours après le discours de Justin Trudeau, Sukhdool Singh Gill est abattu dans une maison de Winnipeg. L’Inde soutient que Hardeep Singh Nijjar et Sukhdool Singh Gill avaient tous deux des liens avec le groupe séparatiste Khalistan Tiger Force. En mai 2024, la GRC arrête trois citoyens indiens et les accuse du meurtre de Hardeep Singh Nijjar. Le Canada expulse ensuite six diplomates indiens du pays en octobre 2024. Les responsables indiens qualifient les allégations du Canada de « grotesques » et ils réagissent en expulsant six diplomates canadiens d’Inde.
Al-Qaïda et le 11 septembre 2001
Dans les années 1990, le Canada abrite au moins deux groupes liés au groupe terroriste islamiste Al-Qaïda. Une cellule du Groupe islamique armé, un groupe algérien affilié à Al-Qaïda, opère à Montréal. Il amasse des fonds par le vol et la fraude. Plusieurs de ses membres ont suivi un entrainement dans un camp d’Al-Qaïda en Afghanistan, dont Ahmed Ressam. Ce dernier est arrêté à Port Angeles dans l’État de Washington en décembre 1999, alors qu’il est en possession d’explosifs et de détonateurs dans le coffre de sa voiture. Ahmed Ressam, que les médias surnomment le Millennium Bomber, comptait faire sauter l’aéroport international de Los Angeles autour du 1er janvier 2000. À Toronto, un autre groupe est dirigé par Ahmed Said Khadr, un ami du chef d’Al-Qaïda Osama ben Laden. Ahmed Said Khadr amasse des fonds au Canada pour financer des attaques islamistes à l’étranger. Ces attaques comprennent l’attentat à la bombe contre l’ambassade d’Égypte à Islamabad en 1995, qui fait 18 morts et 75 blessés.
Les attaques perpétrées par Al-Qaïda à New York et à Washington DC le 11 septembre 2001 font près de 3000 morts, dont deux douzaines de Canadiens. (Voir aussi Le 11 septembre et le Canada.) Le Canada réagit en envoyant des troupes en Afghanistan et dans le golfe Persique dans le cadre de la campagne antiterroriste internationale menée par les États-Unis. (Voir aussi Le Canada et la guerre en Afghanistan.) À l’automne 2001, le Parlement adopte la Loi antiterroriste. Cette loi alourdit les peines pour les actes terroristes et elle facilite le gel ou la saisie des avoirs financiers des personnes soupçonnées de terrorisme. Elle restreint également la divulgation publique de renseignements sensibles et elle confère à la police de nouveaux pouvoirs en matière de surveillance, d’arrestation et de détention. En novembre 2002, Osama ben Laden laisse entendre que le Canada est l’un des pays que le réseau Al-Qaïda ciblerait lors de ses prochains attentats.

La coalition menée par les États-Unis en Afghanistan démantèle les camps d’entrainement d’Al-Qaïda. Elle perturbe également l’organisation du groupe, rendant difficile le lancement de nouvelles attaques. Toutefois, Al-Qaïda a déjà entrainé plusieurs terroristes qui demeurent en contact avec le groupe par l’intermédiaire d’un réseau international. Ces derniers reprennent le flambeau et commettent des attentats à la bombe dans plusieurs villes, dont Bali (2002), Madrid (2004) et Londres (2005).
Al-Qaïda inspire également une menace terroriste domestique au Canada et dans plusieurs autres pays. En 2004, la police arrête Momin Khawaja. Né à Ottawa, Momin Khawaja collabore avec des islamistes britanniques sur un complot visant à faire des attentats à la bombe au Royaume-Uni. En 2008, Momin Khawaja est condamné en vertu de la Loi antiterroriste du Canada. En 2006, la police arrête 18 personnes à Toronto (un groupe apparemment surnommé « Toronto 18 ») et les accuse d’avoir planifié des attaques terroristes. Le groupe avait l’intention de faire exploser des camions piégés à la Bourse de Toronto et au siège régional de Toronto du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Les « Toronto 18 » avaient également l’intention de prendre d’assaut les édifices du Parlement à Ottawa pour prendre des otages et décapiter le premier ministre. Sept des suspects sont libérés après la suspension des accusations portées contre eux. Les onze autres sont éventuellement reconnus coupables.
Lutte contre le terrorisme au Canada
De nombreuses branches du gouvernement fédéral sont impliquées dans les efforts de lutte contre le terrorisme au Canada. Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) est chargé d’enquêter sur les menaces terroristes. L’application des lois antiterroristes du pays relève de la GRC. Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) enquête sur les risques de financement potentiel du terrorisme au Canada. L’Agence des services frontaliers du Canada, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration utilisent des certificats de sécurité pour déporter les personnes qui n’ont pas l’autorisation de séjourner au pays ou qui constituent une grave menace. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (ou Affaires mondiales Canada) travaille en collaboration avec d’autres pays pour combattre le terrorisme. Il partage des renseignements et contribue à l’élaboration d’accords internationaux sur les actes de terrorisme.
Au ministère de la Défense nationale, le chef du renseignement de la Défense dirige une organisation qui analyse les menaces terroristes susceptibles d’affecter les Forces armées canadiennes (FAC). Le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) recueille des renseignements. Il surveille les télécommunications avec l’étranger et d’autres signaux échangés entre terroristes. Le Canada reçoit également des renseignements grâce à des accords de partage avec ses pays alliés. Le Conseil de surveillance et d’examen des activités de renseignement du Groupe des cinq partage des renseignements entre les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La Deuxième Force opérationnelle interarmées (FOI 2), une unité des forces d’opérations spéciales de la FAC, est formée pour mener des opérations antiterroristes au pays et à l’étranger.

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom

.jpg)






