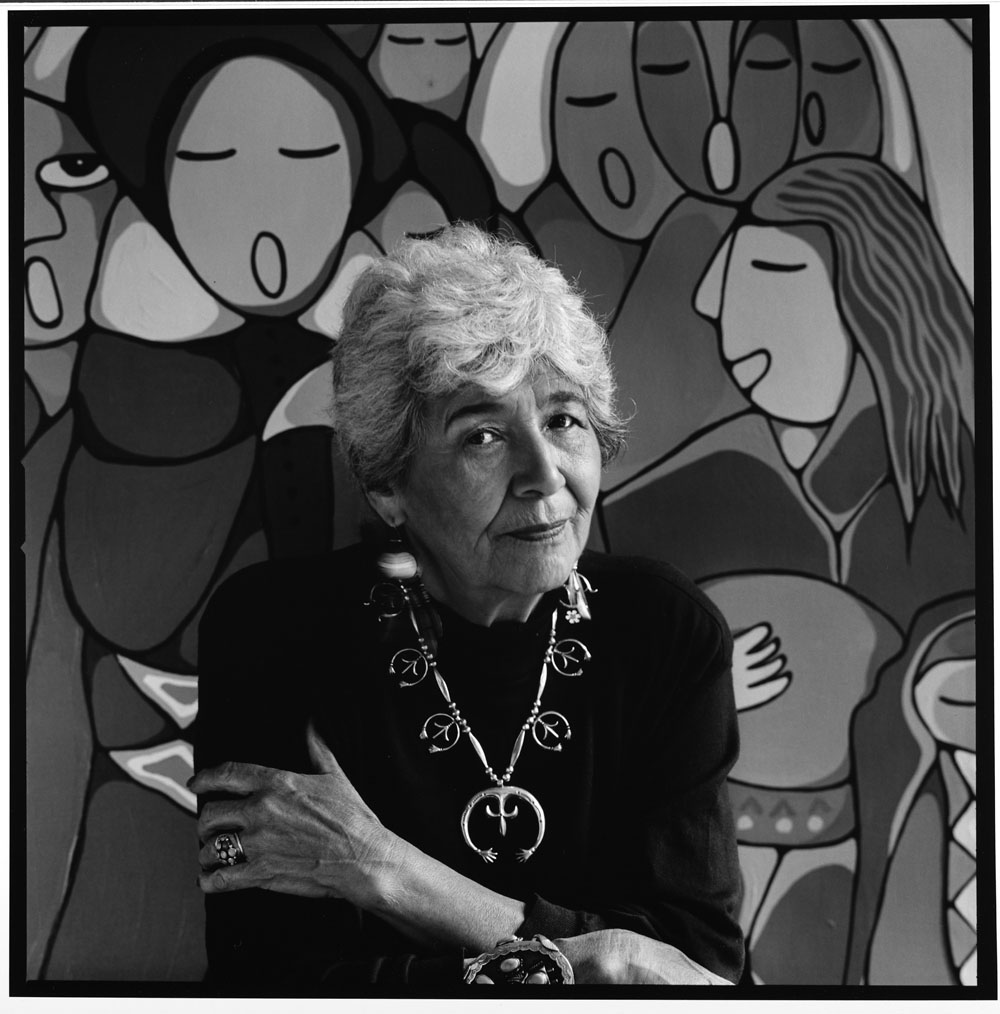Zacharie Vincent (connu sous le nom de Telariolin), artiste (né le 28 janvier 1815 à Jeune-Lorette [maintenant Wendake] au Québec; décédé le 9 octobre 1886 à Québec au Québec). Les œuvres de Zacharie Vincent, peintes dans le grand style européen, étaient vendues aux visiteurs de Jeune-Lorette (maintenant Wendake), aux soldats de la garnison britannique et aux membres de l’élite politique, comme lord Elgin et la princesse Louise de Grande-Bretagne. Une partie de ses œuvres sont aujourd’hui conservées au Musée du Château Ramezay (à Montréal), au Musée canadien de l’histoire (à Gatineau) et au Musée national des beaux-arts du Québec (à Québec), de même que dans des collections privées.

Jeunesse
Zacharie Vincent naît dans une communauté wendat. À la suite d’épidémies et de conflits avec les Haudenosaunee, les Wendats migrent de la région des Grands Lacs vers la région de Québec durant la deuxième moitié du 17e siècle, et ils y vivent sous la protection des missionnaires. Après s’être déplacés à plusieurs reprises, les Wendats s’installent définitivement à Jeune-Lorette (maintenant Wendake) en 1697 et ils y vivent de la chasse et d’artisanat (voir aussi Hurons-Wendat de Wendake). Zacharie Vincent est le fils du chef Gabriel Vincent et de Marie Otisse (Otis, hôtesse). En 1845, il épouse une veuve haudenosaunee nommée Marie Falardeau. Ils ont quatre enfants : Cyprien, Gabriel, Zacharie et Marie.
Éducation
Il est difficile de déterminer le niveau d’alphabétisme de Zacharie Vincent parce qu’il ne signe aucune de ses œuvres. De plus, l’éducation ne devient obligatoire à Lorette qu’à partir de 1830, alors qu’il est adolescent. Il est l’une des rares personnes au 19e siècle à pouvoir encore parler la langue wendat, et il s’inspire presque certainement des codes, des conventions et des éléments rhétoriques de la culture orale dans ses œuvres. En 1838, le peintre Antoine Plamondon peint un portrait de Zacharie Vincent, qui est alors dans la jeune vingtaine, Le dernier Huron. Ce portrait symbolique exprime de manière détournée la crainte des Canadiens français de subir le même sort que les communautés autochtones, qui sont soumises à de considérables pressions pour s’assimiler à la culture coloniale. L’œuvre véhicule également l’image courante de l’Autochtone à l’époque : un sujet fragilisé par le métissage et l’invasion coloniale, et qui est voué à l’extinction. La même année, l’artiste Henry Daniel Thielcke peint un portrait de groupe, Presentation of a Newly Elected Chief of the Huron Tribe. Sur ce tableau, les chefs de la communauté wendat de Jeune-Lorette portent un uniforme officiel, soit une redingote et un chapeau haut de forme, et ils se tiennent autour de Robert Symes, un soldat qui vient d’être nommé chef huron. Afin d’exprimer son individualité, son caractère distinctif et d’afficher son héritage culturel, Zacharie Vincent porte plutôt une coiffe d’argent ornée de plumes qu’il a lui-même conçu. Ce faisant, il cherche à remplacer l’image stéréotypée des peuples autochtones, soit une image homogène, passive, passéiste et défaitiste de l’Autochtone, par une vision dynamique, positive, optimiste.
Œuvres
Zacharie Vincent aurait suivi des cours et aurait bénéficié de conseils d’artistes renommés de l’époque, comme Antoine Plamondon, Cornelius Krieghoff, Théophile Hamel et Eugène Hamel. On estime que son œuvre, composée d’huiles sur toiles, d’œuvres sur papier et de sculptures sur bois, contient des centaines d’œuvres. L’art de Zacharie Vincent couvre une variété de thèmes et de genres allant des autoportraits et des portraits aux paysages et aux scènes de genre. Au cours des années 1870, il incorpore également des photographies qu’il prend au studio de Louis-Prudent Vallée à Québec. Il utilise ces photos à la fois comme référence visuelle au lieu d’un miroir lorsqu’il crée ses autoportraits, et comme outil promotionnel pour faire connaître ses services de peintre et de guide de chasse. La photographie qui le représente devant son chevalet en train de peindre un autoportrait projette une image active et créative d’une personne autochtone qui représente une rupture définitive avec l’imagerie conventionnelle de l’époque.
L’œuvre de Zacharie Vincent exprime et résume les changements majeurs que la communauté wendat vit au milieu du 19e siècle. En raison de la prospérité de son industrie artisanale, la communauté connaît une période de croissance démographique et d’expansion économique. Cependant, le développement des colonies en amont de la vallée du Saint-Laurent, la prospection et la construction de chemins de fer empiètent sur l’espace de vie de la communauté ainsi que sur ses territoires de chasse. L’adoption de la Loi sur les Indiens mine ses efforts d’autonomisation et d’expansion. Face à ces pressions, Zacharie Vincent s’engage à créer un portrait réaliste, actualisé et revitalisé de lui-même et de son peuple.
Ses autoportraits, dont une douzaine sont répertoriés, le dépeignent dans une pose suggérant qu’il évoque à la fois le passé et regarde vers l’avenir. L’artiste se dépeint lui-même dans les vêtements d’un chef, portant une tenue de cérémonie traditionnelle comme le wampum, et exhibant des objets de traité issus d’échanges culturels, comme un calumet de paix, une médaille du traité de la reine Victoria, et des brassards en argent. Dans un même temps, ces portraits évoquent également un dialogue symbolique entre l’artiste et l’élite politique britannique au moyen du mimétisme, ou de l’imitation du monde réel. Par exemple, la coiffe de plumes d’autruche s’inspire directement de l’emblème du Prince de Galles, rappelant que Zacharie Vincent et le jeune Édouard VII sont tous deux des dirigeants politiques et des artistes. Pour Zacharie Vincent, ces rôles partagés contribuent à bâtir une économie de commerce et d’alliances, ainsi qu’à promouvoir la nouvelle image des communautés autochtones.
En plus de ses activités artistiques, Zacharie Vincent occupe le poste de chef guerrier (1845-1852), et ensuite de chef du Conseil (1852-1879). Il est également guide de chasse et éclaireur pour la garnison britannique.
Dernières années
En 1879, Zacharie Vincent et son fils déménagent de Jeune-Lorette pour aller s’installer à Caughnawaga (aujourd’hui la réserve de Kahnawake), un village sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent à Montréal. Ce village est également le siège de la Fédération des Sept Feux. Zacharie Vincent gagne sa vie en fabriquant des raquettes, mais il est possible qu’il ait également joué un rôle d’ambassadeur au sein de la Fédération. Il reçoit de l’aide financière du docteur William Beers, qui achète une vingtaine de ses œuvres sur papier. Elles sont plus tard léguées au Musée du Château Ramezay. Après le décès de Zacharie Vincent en 1886 à l’hôpital de la marine à Québec, William Beers organise une exposition posthume de ses œuvres à l’église presbytérienne Saint-Paul à Montréal.

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom