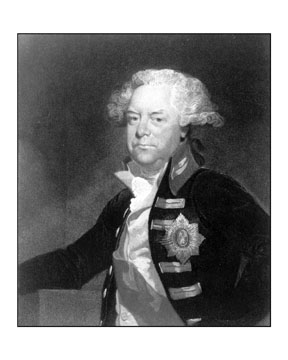Le 6 mars 1834 naît la ville que les Canadiens adorent détester : Toronto.
L'endroit est bien connu par les Hurons, Iroquois, Missisaugas et autres Premières Nations qui empruntent le sentier de portage longeant la rivière Humber jusqu'au lac Simcoe en route vers la baie Georgienne. L'origine du mot «Toronto» est un peu obscure, mais d'après la tradition, ce serait un mot mohawk signifiant «lieu de rencontre».
En septembre 1615, l'explorateur et aventurier français Étienne Brûlé est le premier Européen à emprunter le «passage de Toronto». En 1751, les Français y construisent leur troisième et dernier poste, Fort Rouillé. En 1759, alors qu'ils battent en retraite sous l'assaut final des Anglais, ils l'incendient.
Tour à tour, les Iroquois et les Français y construisent et abandonnent des postes juste avant que les Britanniques achètent le territoire des Missisaugas pour 1700 £, qu'ils paient en argent et en marchandises, sans doute un marché aussi intéressant que celui des Hollandais pour Manhattan. Le 26 août 1793, arrive le lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe. Il baptise l'endroit York en l'honneur de la récente victoire du duc d'York en Hollande et en fait la capitale provisoire du Haut-Canada, lui donnant ainsi un avantage certain sur ses plus proches rivales Kingston et London.
Pendant ce rude hiver, Simcoe occupe ses Rangers à nettoyer le site de la future ville et à tracer des voies : les rues Yonge (du nom du ministre de la Guerre) vers le nord, Dundas (pour le secrétaire de l'Intérieur) vers l'ouest et Danforth (pour le maître d'œuvre) vers l'est.
Le village est doté de sa première prison, en 1799, de son premier journal, l'Upper Canada Gazette, en 1798, et de sa première église, St. James, en 1806.

|
| York, par Elizabeth Hale (ANC C40137) |
Vers la fin des années 1820, une soudaine vague d'immigrants en fait une petite ville coloniale en expansion, marquée par de profonds clivages ethniques, religieux et sociaux parmi les Écossais, Anglais et Irlandais (protestants et catholiques). Pour faire partie de l'élite, il vaut mieux être anglais, mais il faut absolument appartenir à l'Église d'Angleterre.
Ce mélange ethnique et religieux, où bouillonne la lutte pour le pouvoir politique, est un phénomène inconnu en Grande-Bretagne. D'après l'historien Paul Romney, c'est une société dans laquelle «chacun a conscience d'appartenir à une minorité». L'agitateur principal est un brandon écossais du nom de William Lyon Mackenzie, dont les idées incendiaires sèment inlassablement la discorde au sein de l'élite dirigeante. En représailles, les partisans loyalistes lui donnent une raclée et saccagent son atelier d'imprimerie. Au moins, il évite le sort du journaliste Francis Collins, qu'on emprisonne, ou du réformateur George Rolf, qu'on roule dans le goudron et les plumes.
Même si le nombre et la diversité des journaux alimentant la bisbille politique peuvent nous sembler étranges aujourd'hui, nous pourrions reconnaître The Porcupine, un torchon débordant de rumeurs et de ragots : homosexualité, adultère ou liaison, tout y passe, jusqu'au moindre petit travers.
Craignant à juste titre que, en mettant en place des institutions élues, l'incorporation ouvre la porte à n'importe qui - même aux réformateurs - les dirigeants conservateurs s'y opposent. Quand, le 3 avril, Mackenzie est élu premier maire de Toronto, leur pire cauchemar devient réalité.
Entre autres responsabilités, le maire Mackenzie agit comme juge de paix. Chaque jour, défilent devant lui ivrognes, batteurs de femme, trafiquants d'alcool et les violeurs du repos dominical. Il prend son rôle au sérieux, et chacune de ses décisions est critiquée dans la presse par un camp ou l'autre.

|
| William Lyon Mackenzie (Metropolitan Toronto Library) |
Quand Mackenzie publie dans son journal une lettre suggérant que le Haut-Canada aurait intérêt à être une république, il provoque un véritable tollé. Il convoque une assemblée publique pour s'expliquer et discourt tellement longtemps que ses opposants n'ont même pas le temps de réagir à ses propos et que la séance doit être ajournée. Quand l'assemblée est réouverte le lendemain soir, la galerie du hall St Lawrence, pleine à craquer, s'écroule et, en tombant, quatre personnes trouvent la mort, empalées par des crochets de boucherie.
Durant cette première année d'existence, une catastrophe encore pire attend la jeune ville : le choléra envahit les rues polluées, faisant quelque 500 victimes.
Comme on pouvait s'y attendre, le premier mandat du conseil municipal prend fin dans une élection tumultueuse. Les citoyens exprimant leur vote publiquement, on assiste à toutes sortes d'intimidations envers eux et les candidats. La plupart des Irlandais ne peuvent pas voter et s'expriment énergiquement à coups de poings et de bâtons. Quand un robuste groupe d'Irlandais catholiques s'en prend à un groupe d'orangistes protestants, la bagarre tourne à l'émeute et un homme, Patrick Burns, y trouve la mort.
Même la mort de Burns est reprochée à Mackenzie pendant l'enquête qui incrimine son chef de police William Higgins (un jury l'exonérera).
L'élection de janvier 1835 met fin au bref règne de Mackenzie, peut-être à son propre soulagement. Jusqu'ici Toronto porte bien son nom de «lieu de rencontre». Cette première année met en scène les douleurs de la naissance d'une société et ses premiers pas chancelants vers les compromis politiques qui permettront d'apprivoiser la diversité culturelle qui caractérise encore aujourd'hui le Canada et surtout sa principale métropole.

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom