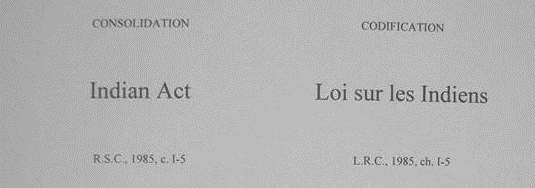Créée en 1969, l’Union of British Columbia Indian Chiefs (UBCIC) est une importante organisation politique autochtone représentant les membres des Premières Nations de la Colombie-Britannique (voir aussi Premières Nations en Colombie-Britannique). Sa création marque un tournant important dans l’activisme politique des Autochtones. Elle offre une tribune unifiée à plus de 200 collectivités des Premières Nations de la province. L’UBCIC milite pour les droits politiques, sociaux et économiques des Premières Nations. Sa mission repose sur l’unité panautochtone, la reconnaissance de la souveraineté autochtone et le maintien des traditions culturelles.
Origines et création
L’Union of British Columbia Indian Chiefs (UBCIC) est créée en 1969 dans le but de servir d’organisme de coordination aux Premières Nations de la Colombie-Britannique. Elle vise à faciliter les interventions collectives face aux défis communs. Elle n’est pas destinée à remplacer les organisations tribales, de bandes ou panautochtones existantes, mais plutôt à les compléter en favorisant la collaboration au sein de la province. L’UBCIC est officiellement lancée lors de la conférence des chefs indiens de la Colombie-Britannique en novembre 1969. Une coalition d’éminents dirigeants autochtones organise cette conférence, présentée par les Tk’emlúps te Secwépemc. Elle réunit au moins 140 délégués de près de 200 Premières Nations de la province. Elle vise à aborder les défis communs auxquels sont confrontées les collectivités autochtones. Sa devise « United we stand, divided we perish » (unis, nous résistons; divisés, nous périssons) souligne l’urgence de la solidarité. L’organisation remet en question les politiques gouvernementales qui visent à miner la souveraineté et l’autodétermination des Autochtones. Les délégués discutent de leurs préoccupations communes et de leur vision d’une action politique unifiée. Grâce à cela, l’UBCIC se positionne en tant que défenseur des droits des Autochtones en Colombie-Britannique.
Contexte historique et antécédents
La création de l’UBCIC n’est pas la première tentative de coopération panautochtone en Colombie-Britannique. Les collectivités autochtones de la région ont une longue histoire de collaboration. Au XVIIIe siècle, par exemple, les Tk’emlúps te Secwépemc et le peuple Syilx de Sp’áxmen (Douglas Lake) concluent l’accord du lac Fish. Cet accord important permet de régler un différend frontalier de longue date et des conflits historiques entre les deux groupes. Les principes de tels accords servent de fondement aux futures organisations politiques panautochtones (voir aussi Organisation politique des Autochtones et activisme au Canada).
Au XXe siècle, on crée diverses organisations régionales et nationales pour répondre aux préoccupations des Autochtones. Toutefois, leur portée, leur longévité et leur influence sont souvent limitées. Cela est principalement dû aux divisions au sein des communautés, aux défis géographiques, à l’étroitesse du champ d’action politique et à la résistance de l’État canadien. Il est difficile d’établir une organisation véritablement unifiée à l’échelle de la province. Cependant, le climat politique des années 1960 crée les conditions d’une plus grande collaboration.
Livre blanc et essor de l’UBCIC
Le Livre blanc de 1969 du gouvernement canadien joue un rôle important dans la création de l’UCICB. Lancé par le gouvernement libéral du premier ministre Pierre Elliott Trudeau, ce document propose des changements radicaux au statut des Premières Nations au Canada. Il préconise l’abolition de la Loi sur les Indiens, la résiliation des traités et la suppression de la reconnaissance juridique spéciale accordée aux Premières Nations (voir Statut d’Indien). En Colombie-Britannique, où les traités se font rares, le gouvernement canadien ne reconnaît pas les droits fonciers des peuples autochtones. Le Livre blanc constitue une menace directe pour l’autonomie autochtone et les revendications territoriales en suspens. En réaction les dirigeants autochtones de la Colombie-Britannique se mobilisent. Ils utilisent l’UBCIC comme plateforme pour organiser leur résistance. Cette mobilisation contribue grandement à l’opposition nationale au Livre blanc. Elle jette également les bases d’un vaste mouvement de défense des droits des Autochtones au Canada.
Structure organisationnelle et représentation
L’UBCIC se veut une entité politique inclusive. Elle vise à représenter l’ensemble des collectivités des Premières Nations de la province. Elle compte trois catégories de membres : les chefs de bande élus, les conseillers élus et les chefs héréditaires. Le conseil des chefs est un organe directeur composé de 15 membres. Il agit à titre de conseil d’administration de l’organisation. Le conseil des chefs est chargé de mettre en œuvre les politiques et d’orienter les activités de l’UBCIC. Chaque membre du conseil représente l’un des 15 districts de l’UBCIC (réduits à 13 en 1979). Ces districts se fondent sur les limites des districts du ministère des Affaires indiennes (voir aussi Ministères fédéraux des Affaires autochtones et du Nord). Cela permet d’assurer la représentation de toutes les régions de la Colombie-Britannique. Certains activistes critiquent l’utilisation de structures prescrites par le ministère des Affaires indiennes. Toutefois, ce système assure une large représentation provinciale.
Bien que l’UBCIC soit structurée pour former un front uni, elle n’est pas exempte de contradictions. L’organisation est fondamentalement hiérarchique, en plus d’être discriminatoire, en particulier en ce qui concerne le sexe et le statut. L’UBCIC s’appuie sur des structures de direction dominées par les hommes et sur les définitions du statut, de l’appartenance à une bande et de la citoyenneté de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, de nombreuses femmes autochtones se retrouvent exclues (voir aussi Les femmes et la Loi sur les Indiens). Par exemple, jusqu’en 1951, les femmes des Premières Nations n’ont pas le droit de se présenter aux postes de direction des conseils de bande élus. On les retrouve donc largement sous-représentées aux postes de chef et de conseiller. Ce qui les exclut automatiquement de l’exécutif de l’UBCIC. Les définitions de statut et d’appartenance fondées sur le sexe dans la Loi sur les Indiens limitent aussi la participation des femmes. Les femmes non inscrites se retrouvent également exclues de leur communauté et des discussions politiques.
Politique genrée et participation des femmes
Les femmes jouent un rôle crucial dans la lutte contre les inégalités. Elles militent pour une plus grande participation et une redéfinition de l’unité politique qui prendrait en compte leurs voix et leurs préoccupations. Elles évoquent l’unité politique et sociale pour plaider en faveur de leur inclusion en tant que membres essentiels de leurs communautés. Elles démontrent également qu’elles ont un intérêt dans les résultats politiques de l’UBCIC.
Les organisations de femmes autochtones critiquent également de plus en plus la direction de l’UBCIC, qui est dominée par les hommes. Elles soutiennent que les dirigeants négligent des questions cruciales, comme le logement, l’éducation et la santé, qui ont un impact direct sur les femmes et les familles. Par contre, plusieurs dirigeants masculins au sein de l’UBCIC accordent la priorité à la souveraineté et aux revendications territoriales. Cette situation engendre des tensions au sein du mouvement. Les groupes de femmes exigent une capacité d’agir et une reconnaissance politiques égales dans la vaste lutte pour les droits des Autochtones. Elles s’engagent à la fois dans des débats féministes autochtones nationaux et dans des alliances avec les mouvements féministes. Les femmes autochtones commencent à contester la Loi sur les Indiens et à lutter pour se faire reconnaître comme des citoyennes politiques au sein de l’UBCIC et des structures politiques autochtones en général.
Financement gouvernemental et tensions politiques
La question du financement suscite aussi des tensions politiques. À ses débuts, l’UBCIC reçoit des fonds de divers programmes du gouvernement fédéral. Ce soutien financier lui permet de se professionnaliser et d’élargir son personnel et ses activités. Cependant, cette dépendance financière crée des divisions au sein de l’organisation. Certains membres craignent que cette dépendance ne menace l’autonomie politique de l’UBCIC. Cette préoccupation conduit à la « décision de Chilliwack » en 1975. L’UBCIC rejette alors toutes les formes de financement public et les structures bureaucratiques qui en découlent, privilégiant ainsi l’action directe et la résistance populaire.
Action directe : « Mai militant »
En réaction à la décision de Chilliwack, l’UBCIC s’engage de plus en plus dans l’action directe, une méthode empruntée au mouvement « Pouvoir rouge » aux États-Unis. En 1975, l’UBCIC participe à une campagne d’un mois d’actions directes, baptisée « Militant May ». Pendant cette période, l’UBCIC organise une série d’occupations, de barrages et d’autres actions partout en Colombie-Britannique. Ces manifestations ciblent des bureaux gouvernementaux, des autoroutes, des lignes de chemin de fer et des routes forestières. Elles visent à affirmer la souveraineté autochtone, à résister à l’occupation des terres et à contester les politiques gouvernementales répressives. Les actions de 1975 marquent une rupture nette avec les méthodes plus bureaucratiques des années précédentes. Elles témoignent d’une évolution vers l’indépendance et la résistance communautaire. Bien que de courte durée, le refus de financement prépare l’UBCIC à relever son prochain défi : le rapatriement de la Constitution.
Rapatriement de la Constitution
Lors des discussions entourant le rapatriement de la Constitution du Canada, l’UBCIC joue un rôle central en prônant la reconnaissance des droits des Autochtones dans la nouvelle constitution. L’organisation cherche à définir la souveraineté autochtone de manière à respecter la diversité des traditions locales et régionales, tout en favorisant l’unité panautochtone. Elle demande à participer activement aux discussions plutôt que d’y assister comme simple observatrice. Ses demandes n’étant pas satisfaites, l’UBCIC coordonne une autre campagne d’actions directes, baptisée « Constitution Express ». En 1980, l’UBCIC organise le transport de plus de 1 000 personnes entre Vancouver et Ottawa à bord de deux trains de passagers. Cette action a pour but d’exiger que les droits des Autochtones soient inscrits dans la Constitution. N’obtenant aucuns résultats, les militants portent leur message aux Nations Unies et en Europe afin d’attirer l’attention internationale sur cette question. Finalement, ils réussissent à faire garantir les droits des Autochtones dans la Loi constitutionnelle de 1982.
Héritage et pertinence continue

À défaut d’atteindre ses objectifs initiaux, l’UBCIC laisse tout de même un vaste héritage. Elle réussit à poser les fondations d’une plateforme politique solide pour les voix autochtones dans le paysage politique canadien. Elle contribue à faire entendre les voix des Autochtones en incluant les droits des Autochtones dans la Loi constitutionnelle de 1982. Bien que ces droits n’y soient pas clairement définis, les actions de l’UBCIC jettent les bases des luttes politiques futures.
Le poids politique de l’organisation commence à s’estomper dans les années qui suivent le débat sur le rapatriement. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, le large appui dont jouit l’UBCIC commence à s’amenuiser. Certaines collectivités se tournent vers d’autres organisations qu’elles jugent mieux à même de défendre leurs intérêts. D’autres entités remettent en question le monopole du pouvoir politique de l’UBCIC et sa reconnaissance par le ministère des Affaires indiennes. Ces groupes prétendent qu’elle n’a pas réussi à atteindre une véritable unité, qu’elle est devenue trop bureaucratique et qu’elle s’est éloignée de la base. Par conséquent, plusieurs Premières Nations se rallient à d’autres organisations, ce qui entraîne une fragmentation du mouvement politique autochtone provincial.
Aujourd’hui, l’UBCIC continue d’exercer une influence significative en Colombie-Britannique et dans la politique autochtone en général. En 2005, l’UBCIC s’associe au Sommet des Premières Nations et à l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique. En 2018, l’organisation abandonne la négociation des traités pour se concentrer sur l’affirmation de la souveraineté autochtone par des moyens légaux et en organisant des manifestations publiques. Elle continue de répondre aux besoins de la collectivité en s’engageant dans des dossiers urgents. Elle s’engage dans la lutte contre les oléoducs, pour les droits des Autochtones et du titre autochtone, pour l’initiative Femmes et filles autochtones disparues et assassinées au Canada et pour la protection de l’environnement. L’héritage durable de l’UBCIC témoigne de la résilience et de l’adaptabilité des mouvements politiques autochtones qui continuent d’évoluer et de redéfinir leurs stratégies pour faire face aux défis permanents.

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom