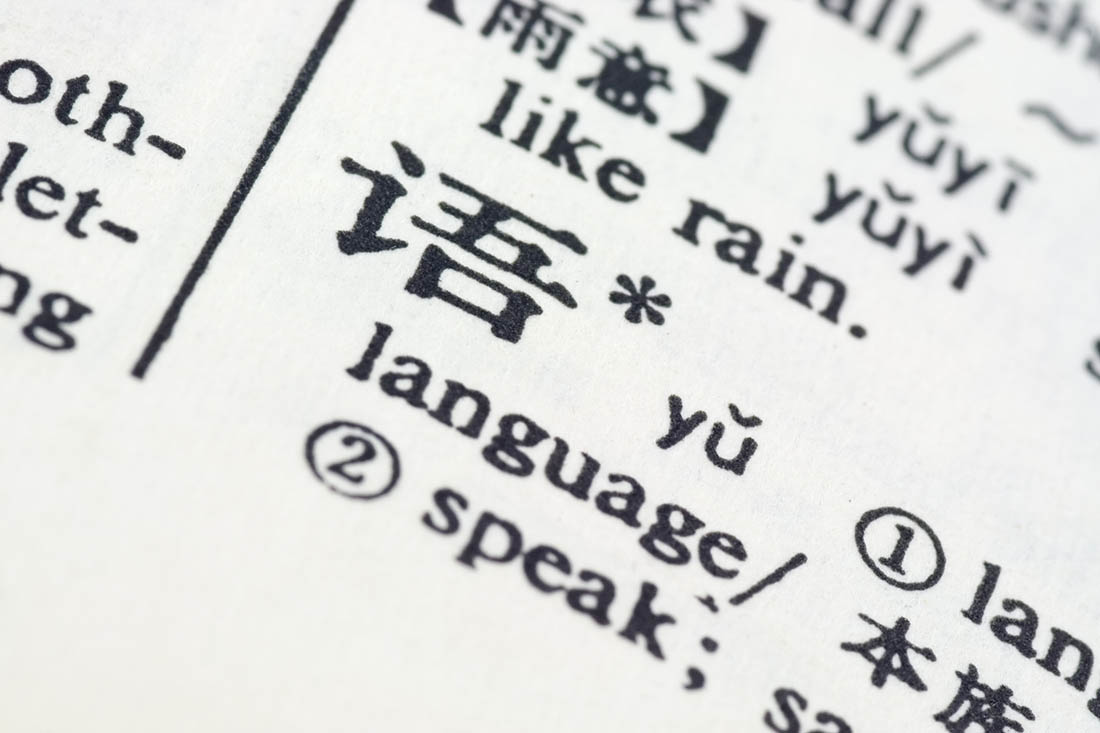Des immigrants taïwanais s’installent au Canada dès les années 1960. D’autres cohortes d’immigrants de Taïwan suivent dans les années 1980 et 1990. Avant les années 1980, la plupart des immigrants taïwanais s’établissaient en Ontario, choisissant de résider à Toronto. Cependant, à partir de 1980, Vancouver devient le lieu de résidence de la plus grande communauté taïwanaise du Canada. Selon le recensement canadien de 2021, environ 65 000 personnes nées à Taïwan vivent au Canada, ce qui représente 0,2 % de la population canadienne. Environ 64 000 Canadiens déclarent avoir des origines taïwanaises.

Taïwan
Taïwan est un État insulaire démocratique autonome, situé au sud-est de la Chine, avec une population d’environ 23 millions d’habitants. On y parle principalement le mandarin, en plus de quelques dialectes indigènes et de dialectes régionaux comme le hakka et le minnan. (Voir aussi Langues chinoises au Canada.)
Les traditions religieuses taïwanaises sont très diversifiées. Bien que le bouddhisme et le taoïsme dominent, ils sont profondément influencés par le confucianisme et diverses croyances populaires. Moins de 10 % de la population pratique le christianisme.
Histoire de l’immigration
Le statut d’État de Taïwan constitue un point de discorde géopolitique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque Taïwan a été rétrocédé à la Chine après la défaite du Japon. En Chine, en 1949, Mao Zedong proclame sa victoire sur le Parti nationaliste de Chiang Kai-shek, le Kuomintang (KMT), appuyé par les États-Unis. Il fonde ensuite la République populaire de Chine, qui adopte un régime communiste s’inspirant du modèle de l’Union soviétique. Chiang Kai-shek s’exile à Taïwan et instaure la loi martiale, plaçant l’île sous le régime autoritaire du KMT. (Voir aussi Relations Canada-Chine.)
Dès les années 1960, des Taïwanais commencent à arriver au Canada pour y faire leurs études supérieures, et plusieurs décident de rester. Ils sont cependant peu nombreux, parce que, jusqu’en 1967, le Canada applique un système d’immigration fondé sur la race, qui discrimine les immigrants non blancs. En 1967, le pays met en place un système de points basé principalement sur les compétences professionnelles, les niveaux d’éducation, les compétences linguistiques et les liens familiaux. (Voir Politique d’immigration au Canada.)
Au Canada, des immigrants taïwanais de la première heure appuient les mouvements démocratiques à Taïwan. Ils dénoncent dans les médias anglais la persécution politique du gouvernement autoritaire du KMT, et ils participent à des manifestations contre le régime unipartite à Taïwan.
Notamment, des aînés de la communauté taïwanaise canadienne racontent leurs expériences en tant que militants à l’étranger dans les années 1970 lors d’un événement organisé par TAIWANfest en 2021. Parmi eux, on compte le Dr Charles Yang, né en 1932, qui arrive à Kingston, en Ontario en 1964, puis exerce la médecine à Richmond, en Colombie-Britannique. Charles Yang, à l’instar de nombreux autres Canadiens qui soutiennent le mouvement démocratique taïwanais, est mis au ban par le KMT pour sa participation à des événements sociaux et politiques au Canada. On lui interdit de revenir à Taïwan pendant plusieurs années.
À la fin des années 1980, les Taïwanais accueillent avec enthousiasme le Programme d’immigration des gens d’affaires du Canada, réservé aux immigrants possédant des fonds pour investir ou créer une entreprise. Plusieurs facteurs contribuent à cette vague d’intérêt, les plus significatifs étant la prospérité économique de Taïwan et sa libéralisation politique après la levée de la loi martiale en 1987. De nombreux immigrants taïwanais évoquent également comme raisons de leur déménagement au Canada une qualité de vie supérieure et une éducation de meilleure qualité pour leurs enfants.
De plus, plusieurs membres de la communauté taïwanaise perçoivent le Canada comme un pays pacifique où ils peuvent immigrer. Il partage avec eux des valeurs communes, comme la liberté, la démocratie, les droits de la personne et le respect de l’État de droit. Alors que les tensions géopolitiques s’intensifient entre Taïwan et la Chine dans les années 1980 et 1990, le Canada devient une voie privilégiée pour ceux qui recherchent la stabilité politique.
Arts et culture
L’identité canadienne d’origine taïwanaise est en constante évolution. Même au début des années 2000, on considère souvent les Canadiens d’origine taïwanaise comme faisant partie de la diaspora chinoise. Mais, au XXIe siècle, au fil de l’évolution de la démocratie de l’île, on considère de plus en plus ces Canadiens comme une communauté distincte.
Des initiatives visant à faire connaître et à promouvoir la culture taïwanaise contribuent à renforcer la reconnaissance des Canadiens d’origine taïwanaise en tant que communauté distincte. Ces dernières célèbrent les caractéristiques culturelles et la cuisine (thé aux perles, nouilles au bœuf, riz frit) que ces personnes contribuent à populariser. Cette communauté se distingue non seulement par sa scène musicale pop mandarine, mais aussi par ses marchés nocturnes animés, qui témoignent de l’hospitalité et de la convivialité de ses membres.
Depuis 2004, l’Asian Canadian Special Events Association (ACSEA) organise chaque année des festivals et des événements, tels que TAIWANfest à Vancouver et à Toronto. Le but de l’ACSEA est de servir de tribune aux artistes, écrivains et historiens de la diaspora taïwanaise au Canada, en divertissant et en éduquant le public. Le festival met souvent en évidence les valeurs communes qui unissent les cultures canadienne et taïwanaise, comme l’acceptation de la diversité et l’inclusivité.
Affaires et politique
Les Canadiens d’origine taïwanaise ont un impact persistant sur tous les aspects de la société canadienne, que ce soit en art, en culture, en politique ou en affaires.
Par exemple, l’entrepreneure taïwanaise canadienne Cindy Lee transforme le secteur de l’épicerie au Canada en fondant le populaire supermarché T&T en 1993. Cette chaîne d’épiceries permet aux Canadiens originaires d’Asie de l’Est d’acheter sous un même toit des produits alimentaires couramment utilisés dans la cuisine asiatique. Après la retraite de Cindy Lee en 2014, la chaîne passe sous la direction de sa fille Tina Lee. Elle continue de s’étendre dans l’est du Canada et aux États-Unis.
Sur la scène politique, les Canadiens d’origine taïwanaise laissent aussi leur marque. Chungsen Leung est le premier politicien taïwanais canadien élu à la Chambre des communes. Il est député conservateur de Willowdale, en Ontario, de 2011 à 2015.
En 2017, Anne Kang, Bowinn Ma et Katrina Chen marquent l’histoire en devenant les premières politiciennes d’origine thaïlandaise élues à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, toutes sous la bannière du Nouveau Parti démocratique.
Relations Canada-Taïwan
Le Canada n’entretient pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan. La politique d’une seule Chine, qui reconnaît la République populaire de Chine comme étant le gouvernement légitime du pays, encadre ses échanges. Cependant, le Canada se tient à l’écart du débat entourant la position de la Chine à l’égard de Taïwan, qui considère l’île comme faisant partie de son territoire. (Voir Relations Canada-Chine.)
Cette position permet au Canada de maintenir des liens commerciaux, d’investissement et diplomatiques avec Taïwan. Selon Affaires mondiales Canada, les échanges commerciaux entre Taïwan et le Canada s’élèvent à 12 milliards de dollars en 2023. Taïwan est le 15e partenaire commercial du Canada. Les secteurs prioritaires du Canada à Taïwan comprennent l’aérospatiale, la technologie de l’information et des communications, les produits agroalimentaires et de la mer, la biotechnologie, les technologies propres et l’énergie.

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom