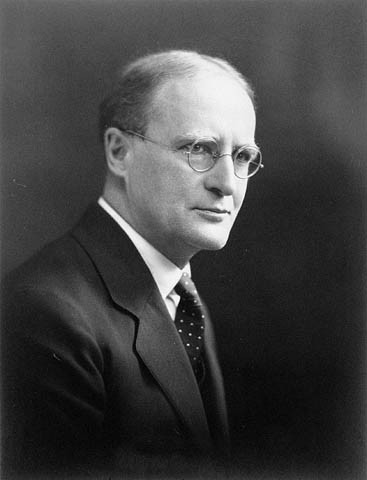Isabel Skelton (née Murphy), historienne, autrice (née le 9 juillet 1877 à Antrim en Ontario; décédée le 22 août 1956 à Montréal au Québec). Autrice de critiques littéraires, d’articles historiques, de trois ouvrages historiques et biographiques et de trois manuels d’histoire pour l’école secondaire, Isabel Skelton a été l’une des premières historiennes canadiennes à analyser le rôle des femmes en tant que groupe dans l’histoire sociale du Canada.

Jeunesse et éducation
Isabel Murphy est l’aînée des trois enfants survivants de Mary Jane « Jeannie » Holliday, une enseignante, et d’Alexander Murphy, un agriculteur, commissaire d’école, maitre de poste, greffier de canton et juge de paix. Elle fréquente la Arnprior District High School, et elle fait ensuite des études à l’Université Queen’s à Kingston en Ontario en 1897, où elle se spécialise en anglais et en histoire. Elle obtient une maitrise ès arts et reçoit la médaille d’or en histoire en 1901. En tant qu’étudiante à l’Université Queen’s, elle est trésorière de la Levana Society pour femmes universitaires.
Mariage
Le 16 août 1904, Isabel Murphy épouse Oscar Douglas Skelton à la ferme de sa famille, à Antrim. Le couple se rencontre alors qu’ils étudient à l’Université Queen’s. Ils passent cinq mois à voyager au Royaume-Uni et en Europe pour leur lune de miel et ils s’installent ensuite aux États-Unis, où Oscar travaille sur son doctorat à l’Université de Chicago. Les Skelton partagent des intérêts intellectuels et des opinions politiques communs : tous deux estiment que le Canada a besoin d’une plus grande autonomie en matière de politique étrangère par rapport au Royaume-Uni. En tant qu’auteurs, ils s’encouragent et révisent mutuellement leurs travaux. Pendant les absences fréquentes d’Oscar pour des recherches universitaires et des fonctions publiques, il écrit des lettres affectueuses à sa femme, l’appelant « Iso » et « Darling Mine ». Elle écrit également à Oscar, mais ses lettres n’ont pas survécu. Elle est cependant frustrée par le lourd fardeau des responsabilités domestiques qui accompagnent le mariage et la maternité, craignant de ne pas avoir le temps d’écrire et de devenir « un exemple pitoyable de femme qui abandonne son propre travail pour faire la vaisselle ».

Enfants
Isabel et Oscar Skelton ont trois enfants; Douglas Alexander « Sandy » (1907-1950), Herbert Hall (1909-1987) et Sheila Isabel Halliday (1918-1998). La santé d’Isabel se dégrade au fil de ses grossesses. Elle perd ses cheveux, elle a des caries dentaires et des varices avant et immédiatement après la naissance de Sandy. Les absences fréquentes d’Oscar signifient que c’est elle qui doit s’occuper en grande partie d’élever et éduquer les enfants, tout en s’occupant de ses propres écrits, de la gestion du foyer des Skelton et de ses responsabilités sociales pour soutenir la carrière de son mari. Elle déclare plus tard dans sa vie : « Nous n’avons pas suffisamment porté d’attention aux garçons, ou à nous-mêmes. J’ai donné plus à Sheila, et elle est une joie. »
Université Queen’s
En 1909, Isabel et Oscar Skelton s’installent à Kingston lorsque ce dernier devient professeur de la chaire de sciences politiques et d’économie John A. Macdonald à l’Université Queen’s. Il devient ensuite doyen de la faculté des arts de 1919 à 1925. Isabel Skelton est active au sein d’organisations féminines sur le campus, comme la Queen’s University Alumni Association. Elle devient présidente du Women’s Canadian Club de Kingston en 1915. En 1922, elle est la seule femme membre de la délégation canadienne à la Conférence panaméricaine de Rio de Janeiro.
À l’Université Queen’s, elle présente et publie des articles sur la littérature et l’histoire, incluant des études sur les romancières britanniques et américaines Mary Ward et Edith Wharton, pour le Westminster Magazine de Toronto en 1910. Elle se porte également à la défense du droit de vote des femmes au Canada, écrivant un article pour The Canadian Magazine qui déclare que les électrices pourraient obtenir une « justice législative en ce qui concerne les droits de propriété, le mariage et le divorce et la tutelle de leurs enfants ».
Érudition en histoire
En tant qu’historienne, Isabel Skelton remet en question la prédominance de la biographie politique dans l’historiographie canadienne, qui met l’accent sur les réalisations des « grands hommes » et de quelques « grandes femmes » considérées comme des héroïnes, comme Laura Secord. Isabel Skelton défend plutôt l’inclusion de la culture matérielle, de la littérature, de la philosophie et de la sphère domestique dans l’écriture de l’histoire.
En 1915, Isabel Skelton propose un livre sur l’histoire des femmes canadiennes pour la série Chronicles of Canada, qui doit être publié par Robert Glasgow de United Editors Limited. Dans la section sur la Nouvelle-France, elle présente une série de courtes biographies de femmes célèbres, comme Marie Hébert, Marie de l’Incarnation et Marie-Madeleine Jarret de Verchères. Cependant, les chapitres sur les femmes loyalistes et les femmes colonisatrices du Haut-Canada considèrent les femmes comme un groupe, tout comme l’impact de leurs activités domestiques sur le développement de la société et de la nation canadiennes.
En 1916, Robert Glasgow déménage aux États-Unis et Isabel Skelton rachète les droits de son manuscrit. Son livre The Backwoodswoman : A Chronicle of Pioneer Home Life in Upper and Lower Canada est finalement publié par The Ryerson Press en 1924. Les recherches d’Isabel Skelton sur l’histoire des femmes canadiennes n’ont pas d’impact immédiat sur les histoires académiques du Canada, mais ses travaux influencent la rédaction de manuels scolaires canadiens, incluant le manuel Building the Canadian Nation (1942) de l’historien George Brown de l’Université de Toronto.
Le deuxième livre d’Isabel Skelton, The Life of Thomas D’Arcy McGee, est publié en 1925, l’année du centenaire de la naissance de Thomas D’Arcy McGee, et il reçoit des critiques favorables, surtout en Irlande et aux États-Unis. Au Canada, l’accent mis par Isabel Skelton sur les efforts littéraires de Thomas D’Arcy McGee et ses idées de nationalisme culturel suscitent quelques reproches de la part des critiques qui s’attendent à une biographie politique traditionnelle centrée sur sa période en tant que député avant son assassinat en 1868.

Ottawa
En mars 1925, le premier ministre William Lyon Mackenzie King nomme Oscar Skelton sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères, et la famille Skelton s’installe à Ottawa. Isabel Skelton est mécontente de ce déménagement qui la sépare de son réseau universitaire de l’Université Queen’s. Le couple n’est pas d’accord sur l’endroit où ils doivent vivre à Ottawa : il préfère une maison plus grande à Rockcliffe Park qui reflète son éminent statut dans la fonction publique, tandis qu’elle préfère une maison plus petite qui nécessite moins d’entretien et lui laisserait plus de temps pour ses recherches et son écriture. Elle écrit dans son journal en août 1925 : « Ces maudites maisons sont entre nous, et je trouve tout à fait impossible de discuter de la question. » Les désirs d’Oscar prévalent. Isabel supervise la rénovation de la maison qu’ils nomment « Edgehill ».
À Ottawa, Isabel Skelton s’implique activement auprès des Guides du Canada et de l’Église anglicane St. George et elle donne des conférences publiques sur l’histoire et la littérature pour des organisations féminines et des établissements d’enseignement, comme le Ottawa Ladies’ College. Elle écrit trois courts manuels d’histoire canadienne pour élèves au sujet de Thomas D’Arcy McGee, de Jean de Brébeuf et d’Issac Jogues, respectivement, pour la maison d’édition Ryerson Press dans les années 1930. Pendant que son mari travaille au ministère des Affaires étrangères, elle l’accompagne à l’occasion au Royaume-Uni et en Europe, et elle assiste au couronnement du roi George VI avec son mari et sa fille en 1937.
Vie ultérieure
Oscar Skelton meurt d’une crise cardiaque alors qu’il conduit dans le centre-ville d’Ottawa en 1941. Isabel Skelton, alors veuve, quitte Ottawa et s’installe à Montréal afin de vivre plus près de son fils Herbert et de sa femme, Daisy May McCracken. Elle continue à participer activement à la vie publique durant la Deuxième Guerre mondiale, siégeant avec d’autres auteurs et universitaires au Comité de coopération en matière de citoyenneté canadienne, un organisme destiné à mettre les nouveaux Canadiens en contact avec les efforts patriotiques en temps de guerre. Au sein de ce comité, elle recommande des livres d’histoire canadienne aux nouveaux Canadiens et elle écrit des articles sur des personnages historiques canadiens, comme John Graves Simcoe. Elle consacre ses dernières années à l’écriture de son dernier livre, A Man Austere : William Bell, Parson and Pioneer (1947), une étude sur un personnage clé du développement de l’Église presbytérienne au Canada.

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom