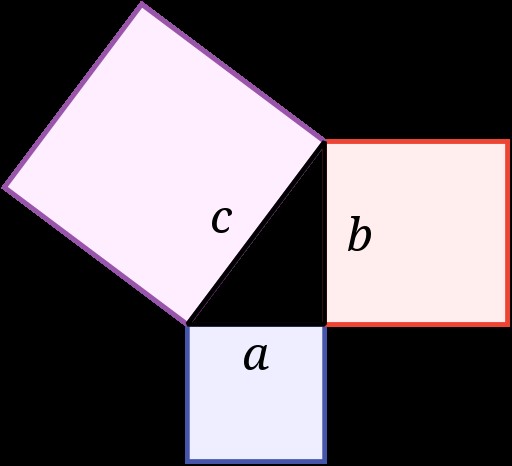Saadia Muzaffar, entrepreneure technologique, militante, auteure (née en 1977 à Karachi, au Pakistan). Elle a promu l’avancement des femmes, en particulier des Autochtones, des immigrantes, des réfugiées et des membres de la communauté 2SLGBTQ+, dans les domaines technologiques liés aux STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). (Voir aussi Immigration au Canada; Droits des 2SLGBTQ+ au Canada.) Elle a milité en faveur d’une plus grande responsabilité dans l’innovation technique, notamment en critiquant Waterfront Toronto pour son partenariat avec Sidewalk Labs en vue de créer un quartier axé sur la technologie dans le quartier Port Lands à Toronto.
Cet article a ete redige en collaboration avec le Museum of Toronto.

Origines
Saadia Muzaffar naît à Karachi, au Pakistan. Elle est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants qui, dès leur plus jeune âge, encouragés par leur père ingénieur, développent une passion pour les machines et les chiffres. « Il nous a élevés de manière non sexiste, raconte-t-elle dans un article de Chatelaine. Il disait que nous pouvions accomplir tout ce que peuvent faire des garçons, et il le pensait vraiment. » Elle ajoute qu’un de ses meilleurs conseils était : « maîtrisez l’art de choisir ce qui vous effraie ».
Malgré cet encouragement, les stéréotypes sociétaux sur les femmes et la science influencent la décision de Saadi Muzaffar d’étudier en administration des affaires (marketing) au Collège Sheridan après son immigration au Canada à l’âge de 19 ans. Elle obtient ensuite un diplôme en communication et en journalisme de l’Université York. Après avoir travaillé pendant trois ans dans le secteur financier, elle fait son entrée dans le monde des technologies par l’intermédiaire du Research Innovation Commercialization Centre basé à Toronto. Ce centre voit rarement des femmes parmi sa clientèle de jeunes pousses technologiques.
« Je savais qu’il y aurait de nouvelles occasions, déclare-t-elle à Chatelaine en 2015. J’étais aussi un peu naïve, avec le recul, de croire que, si un endroit dit que les femmes et les hommes sont égaux, c’est qu’il le pense vraiment. Ce que j’ai appris, c’est que cela signifie des choses différentes selon les endroits et que nous avons du pain sur la planche ici aussi. Dans beaucoup d’endroits, je m’intégrais beaucoup plus facilement, là où ma mobilité n’était pas entravée par le fait d’être une jeune femme; mais ici, c’est la couleur de ma peau qui me distingue. Souvent, j’étais la seule femme, et la seule personne de couleur dans les salles de réunion. C’est difficile. Parfois, on se sent seul. »
Saadia Muzaffar travaille aussi comme directrice principale du marketing à AudienceView, un fabricant de logiciels.
Militantisme
Interrogée en 2017 sur l’évolution de sa vision du féminisme au fil du temps, Saadia Muzaffar explique qu’au début de sa carrière, « ma vision de la justice était très liée à ce que j’incarnais comme identité. Mon féminisme ressentait les inégalités d’être non seulement une femme, mais une immigrante queer de couleur. Au fil de mon apprentissage et de mon engagement, mon militantisme a mis en évidence des expériences que je ne partageais pas : l’identité trans et non binaire, le racisme envers les Noirs, la pauvreté, les handicaps physiques et la maladie mentale. Mon féminisme est devenu beaucoup plus intersectionnel ». (Voir aussi Intersectionnalité.)
Saadia Muzaffar croit que, même si le Canada réussit bien à attirer des travailleurs qualifiés en STIM, les entreprises considèrent souvent les immigrants, en particulier les femmes, comme une main-d’œuvre bon marché. Son travail dans le secteur des technologies l’expose à des blagues racistes et lui rappelle constamment que les personnes comme elle se heurtent à de nombreux obstacles et à un environnement hostile et non inclusif dans le secteur des jeunes pousses.
En 2011, Saadia Muzaffaar fonde TechGirls Canada (TGC), une organisation à but non lucratif qui promeut l’avancement des femmes marginalisées dans le secteur des STIM. Elle se concentre sur les communautés immigrantes, racisées, autochtones, 2SLGBTQ+ et réfugiées. (Voir aussi Immigration au Canada; Droits des 2SLGBTQ+ au Canada.) « TechGirls Canada est né de la pure frustration d’être non seulement une femme en technologie, mais aussi une femme de couleur, et de constater qu’on ne reconnaissait pas suffisamment ce manque de diversité », mentionne-t-on en 2017 à TVO Today. Les efforts de TGC comprennent des recherches sur les femmes dans les STIM, des collaborations avec des artistes et des communautés, des programmes d’avancement professionnel et la promotion d’histoires de réussite.
« Quand on est une jeune fille, on ne cherche pas à se battre avec le monde, fait remarquer Saadia Muzaffar dans un article paru en 2015 dans Chatelaine. Mais prends des risques, deviens une personne différente de celle qu’on te dit d’être. »
Saadia Muzaffar est aussi cofondatrice de Tech Reset Canada. Cette entreprise préconise l’innovation technologique au service de l’intérêt public, une plus grande transparence dans l’infrastructure numérique publique et l’utilisation des données, ainsi que l’investissement dans le renforcement des capacités technologiques et de l’expertise dans le secteur public. « Il faut tenir compte de la distance et du rapport de force entre ceux qui développent et commercialisent la technologie qui entre sur le marché et notre capacité collective à la gérer », peut-on lire sur le site Web de Tech Reset Canada.

Waterfront Toronto et Sidewalk Labs
Saadia Muzaffar fait partie du groupe consultatif sur la stratégie numérique de Waterfront Toronto, qui mène des consultations sur la confidentialité des données et d’autres préoccupations liées à l’utilisation de la technologie dans la conception d’une « ville intelligente » à Ports Lands, à Toronto. Ce projet est issu d’une collaboration entre Waterfront Toronto et Sidewalk Labs, une filiale d’Alphabet Inc., la maison-mère de Google. Les membres du groupe consultatif proviennent de différents milieux intéressés par la technologie, notamment des universitaires, des cadres techniques et des urbanistes.
Elle s’inquiète de plus en plus de la façon dont les préoccupations concernant la collecte et l’utilisation des données sont écartées ou ignorées. Elle craint aussi que le projet ne profite financièrement qu’à Sidewalk Labs plutôt qu’aux innovateurs locaux ou au grand public.
Le 4 octobre 2018, elle remet sa lettre de démission, dans laquelle elle critique Waterfront Toronto pour « son apathie et son absence totale de leadership à l’égard de la précarité de la confiance du public et de l’acceptabilité sociale ». Elle lui reproche de ne pas considérer ses questions et ses préoccupations au sujet des données et de l’infrastructure numérique, en particulier celles concernant les rapports selon lesquels Sidewalk Labs souhaite s’approprier la propriété intellectuelle des consultants locaux travaillant sur le projet. On estime qu’il y a suffisamment de preuves pour montrer qu’une ville dirigée par une entreprise technologique et axée sur la surveillance ne devrait pas exister. En effet, elle priverait les résidents de leur droit de vote, enlèverait de l’argent aux budgets publics et engagerait des fonds publics pour le maintien de technologies inutiles.
Saadia Muzaffar conclut que « les Torontois ne pourront tirer profit d’une gouvernance efficace que si Waterfront Toronto garantit que les organismes publics supervisent non seulement les données, mais aussi l’infrastructure technologique sous-jacente de chacun de ses projets de développement ».
Quelques mois après avoir démissionné, comme plusieurs autres membres du groupe durant le deuxième semestre de 2018, Saadia Muzaffar participe à la campagne #BlockSidewalk. Le projet, rebaptisé Quayside, est annulé en mai 2020.
Écriture
Saadia Muzaffar publie plusieurs nouvelles, dont l’une est sélectionnée pour le prix Pushcart en 2018. Elle contribue également à un essai sur la diversité de genre dans les STIM pour l’anthologie de 2019 Some Thoughts.
Distinctions
Saadia Muzaffar figure aussi dans le livre de Paulina Cameron de 2017, Canada 150 Women, ainsi que dans l’exposition du Museum of Toronto, The 52: Stories of Women Who Transformed Toronto. En 2023, elle est déléguée canadienne à la 67e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. En 2024, l’organisme Women in Communications and Technology lui décerne le prix d’excellence en leadership dans la catégorie « Femme de l’année ».

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom