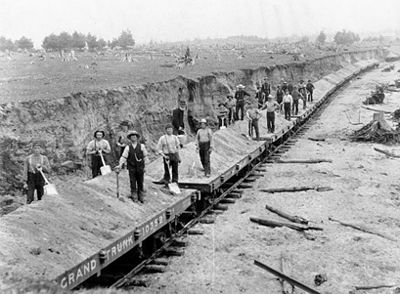L’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) était un accord sur le commerce international. Il a été signé par 23 pays, dont le Canada, en 1947. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1948. Le GATT portait principalement sur le commerce des biens. Il visait à réduire les tarifs douaniers et à éliminer les quotas entre les pays membres. Le GATT a entrainé une réduction des tarifs douaniers moyens de 40 % en 1947 à moins de 5 % en 1993. Le GATT fait partie des premières mesures de mondialisation. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a remplacé le GATT le 1er janvier 1995.
(Cet article est un résumé en langage simple de l’Accord général sur les tarifs douaniers [GATT]. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, veuillez consulter notre article complet, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)).
Sixième cycle de négociations du GATT
Cycle Kennedy, sixième cycle de négociations du GATT, à Genève en Suisse, le 4 mai 1964.
(photo par -/AFP via Getty Images)
Genèse du GATT
Le GATT vise à réglementer le commerce mondial. C’est un moyen de stimuler l’économie mondiale après la Deuxième Guerre mondiale. On veut réduire ou supprimer les tarifs douaniers, les quotas et les subventions. Un tarif douanier est une taxe sur les biens et les services échangés entre des pays. Un tarif douanier peut rendre les biens ou les services d’un autre pays plus chers à importer (introduire dans un pays). C’est un des moyens de protéger les entreprises nationales ou locales (voir aussi Protectionnisme). Un quota est une limite. C’est une restriction du nombre ou de la valeur des biens achetés ou vendus. Une subvention est une somme d’argent que les gouvernements accordent aux entreprises ou aux industries pour éviter que le prix des biens et des services augmente.
Pendant la crise économique des années 1930, les relations internationales perdent la cote. La hausse des règles commerciales et du protectionnisme aggrave l’économie mondiale, déjà mal en point. C’est d’ailleurs l’un des facteurs qui contribuent à la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, les Alliés ne veulent pas répéter les mêmes erreurs. On préfère rendre les pays économiquement dépendants l’un de l’autre. Ainsi, on privilégierait les partenariats et réduirait les risques de conflit. C’est une sorte de code de conduite qui supprimerait ou assouplirait les obstacles au commerce. Le code encadrerait le travail des pays pour élaborer des politiques et régler les conflits qui surviennent. On recueillerait et analyserait aussi des données montrant les tendances observables dans le commerce pour que tout le monde puisse en bénéficier.
Le GATT a un rôle de premier plan dans la guerre froide. C’est grâce à lui que l’Occident capitaliste dirigé par les États-Unis crée un commerce libre avec des accords entre plusieurs pays. L’Occident, dont le Canada fait partie, se fait de nouveaux alliés grâce à ces accords. L’Occident accroît ainsi son influence. Après la guerre froide, le GATT devient officiellement une organisation mondiale, l’OMC. Les pays de l’ancien bloc communiste comme la République tchèque, la Pologne et la Roumanie peuvent en devenir membres.
Conférences du GATT
Le GATT est abordé pour la première fois lors d’une conférence des Nations Unies en 1947. C’est là qu’est lancée l’idée de créer une Organisation internationale du commerce (OIC). On espère que l’OIC aidera la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) à favoriser les coopérations entre pays. Le Canada et 22 autres pays signent le GATT le 30 octobre 1947. L’Accord entre en vigueur le 1er janvier 1948.
On croit au départ que l’OIC serait plus importante que le GATT. Mais les États-Unis s’en retirent en 1950. Le GATT devient alors le centre de l’attention. Huit cycles (ou « round ») de négociations sont organisés de 1947 à 1994 sous la forme de conférences commerciales. Le GATT est créé après le premier cycle, en 1947.
Négociations entre pays
Le Canada conclut des accords individuels avec sept des 23 pays du GATT. Les négociations avec les États-Unis sont les plus importantes. Le Canada avait conclu des pactes commerciaux avec les États-Unis en 1935 et 1938. Mais après la signature du GATT, c’est ce dernier qui dicte les règles entre les deux pays.
Selon les règles du GATT, un pays membre doit accorder à tous les autres membres les mêmes privilèges que ceux qu’il a accordés à sa nation la plus favorisée (NPF). C’est la règle de la NPF. L’Accord contribue ainsi à éliminer les barrières commerciales.
Groupes commerciaux multinationaux
Plusieurs groupes commerciaux multinationaux accompagnent le GATT. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Quadrilatérale et le Groupe de Cairns des nations engagées en faveur d’échanges commerciaux équitables en sont des exemples. En intégrant chacun de ces groupes, le Canada peut orienter les négociations commerciales.
La Quadrilatérale, ou Quad, est le groupe le plus influent d’entre eux. Elle compte quatre membres, le Canada, le Japon, les États-Unis et l’Union européenne. Ce sont à l’époque les plus importantes entités commerciales. La Quad devient une alliance plus officielle au sommet du G7 de 1981. De 1986 à 1994, une période du cycle d’Uruguay, la Quad s’affaire à régler des dossiers agricoles et propose la création de l’OMC.
Des avantages pour le Canada?
Certaines exceptions à la règle de la NPF sont autorisées. Le Canada bénéficie de plusieurs d’entre elles. Les États-Unis se voient autorisés de signer l’Accord canado-américain sur les produits de l’industrie automobile (Pacte de l’automobile) en 1965. Le Canada fait aussi partie de certains pays industrialisés autorisés à accorder des préférences aux pays en développement conformément au Système généralisé de préférences. Le Canada fait de plus partie de l’Arrangement multifibres (AMF). Celle-ci permet aux pays industrialisés de restreindre la quantité de textile importée de pays en développement.
Finalement, les accords de libre-échange entre pays sont autorisés. Cette autorisation entraine l’établissement de l’Accord commercial Canada–États-Unis en 1989 et de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) en 1994 (voir aussi Accord Canada–États-Unis–Mexique).
Subventions à l’importation et à l’exportation
En règle générale, le GATT ne permet pas de limiter les subventions à l’importation et à l’exportation. Certaines exceptions sont cependant accordées. Le Canada a droit à deux exceptions importantes : l’AMF et les dispositions relatives aux produits agricoles. Les États-Unis veulent que ces derniers soient exclus du GATT. Le Canada et d’autres grands pays exportateurs de produits agricoles s’y opposent. Le Canada s’oppose aussi à la dérogation spéciale accordée aux États-Unis en 1955 pour limiter les importations de produits laitiers. L’Allemagne et la Suisse obtiennent d’autres dérogations leur permettant de limiter les importations de produits agricoles. De plus, le Canada limite les importations de céréales et de produits laitiers et de volaille. Il obtient des subventions à l’exportation pour les produits laitiers et les œufs, afin d’écouler ses stocks excédentaires.
Les exclusions et dérogations du GATT donnent lieu à une variété de restrictions sur les importations agricoles et de subventions à l’exportation. Celles-ci nuisent depuis à la production mondiale et aux échanges commerciaux liés à l’agriculture.
Le GATT interdit aussi le dumping. Le dumping est une pratique par laquelle des produits sont vendus à l’étranger à un prix inférieur à celui auquel ils sont vendus dans le pays d’origine. Des droits antidumping peuvent être imposés aux pays ayant recours à cette pratique.
Cycle d’Uruguay
Cycle d’Uruguay
Cérémonie d’ouverture de la conférence ministérielle du GATT à Marrakech au Maroc, le 12 avril 1994. Le cycle d’Uruguay débute en septembre 1986 et se termine le 15 avril 1994.
(Photo par ABDELHAK SENN/AFP via Getty Images)
Le cycle de discussions commerciales le plus important des négociations du GATT est le cycle d’Uruguay. Il débute en septembre 1986 et se termine le 15 avril 1994. Ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1995. L’accord prévoit des changements importants au GATT. Il aborde des enjeux non couverts par les règles habituelles du GATT. Il s’agit notamment des mesures d’investissements liées au commerce; le commerce des services, les droits liés à la propriété intellectuelle, l’ agriculture, le textile et les vêtements. Il traite également les enjeux qui n’ont pas été réglés, comme les garanties et les procédures de règlement des différends. À la fin du cycle d’Uruguay, 128 pays font partie du GATT.
Création de l’OMC

L’accord conclu lors du cycle d’Uruguay donne lieu à l’OMC. L’OMC comprend tous les accords et arrangements du cycle d’Uruguay. Le GATT est conclu à la fin du cycle d’Uruguay, le 15 avril 1994. L’OMC entre en vigueur le 1er janvier 1995. Le GATT reste tout de même l’accord-cadre de l’OMC pour ce qui est du commerce des marchandises. Les pays qui souhaitent adhérer à l’OMC doivent d’abord devenir membres du GATT. En août 2024, 166 pays sont membres de l’OMC et 23 autres pays sont observateurs (en voie d’adhésion).

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom







_IMO_9785756,_Maasmond_pic.jpg)