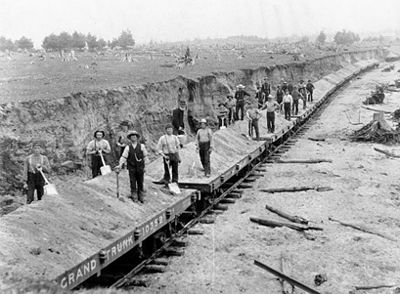Le libre-échange est l’échange de biens et de services entre nations sans tarifs protecteurs imposés. Le Canada a conclu quinze accords de libre-échange avec plus de 50 pays. Ces accords donnent aux entreprises canadiennes accès à environ 1,5 milliard de consommateurs dans le monde entier. (Voir aussi Commerce international.) Ces accords comprennent l’Accord Canada–États-Unis-Mexique (ACEUM) qui est entré en vigueur le 1er juillet 2020.

Marché nord-américain
En mai 1986, le Canada et les États-Unis entament des négociations en vue d’un accord bilatéral de libre-échange. L’accord est conclu en octobre 1987. Il devient le principal enjeu des élections canadiennes de l’automne 1988. Le gouvernement conservateur du premier ministre Brian Mulroney soutient l’accord et remporte les élections. L’accord, connu sous le nom d’Accord de libre-échange canado-américain (ALÉ), entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Subséquemment, les États-Unis et le Mexique annoncent leur intention de conclure un accord de libéralisation du commerce et des investissements. Le Canada demande à prendre part aux négociations. En conséquence, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) est signé et entre en vigueur le 1er janvier 1994, créant une immense zone de libre-échange d’environ 370 millions de personnes. Il prolonge et remplace l’ALÉ, dont il s’inspire.
L’ALÉNA est révisé et remplacé par l’ACEUM le 1er juillet 2020. L’ACEUM conserve de nombreux éléments de l’ALÉNA, mais il inclut des chapitres sur le travail, l’environnement, les petites et moyennes entreprises, et le commerce numérique. Le marché de l’ACEUM compte environ 500 millions de personnes. Selon Affaires mondiales Canada, en 2023, le Canada, les États-Unis et le Mexique « ont importé entre eux des marchandises d’une valeur totale de près de 2000 milliards de dollars ». (Voir aussi Importation; Exportations du Canada.)
Accès aux marchés américains
Traditionnellement, les négociations de libre-échange portent principalement sur l’élimination des tarifs douaniers et des réglementations quantitatives touchant le commerce des marchandises. Mais pour les Canadiens qui exportent ou ceux qui désirent exporter aux États-Unis, les tarifs ne sont pas la principale préoccupation. (Voir aussi Exportations du Canada; Commerce international.) Même avant l’ALÉ, 80 % des envois canadiens entrent en franchise de droits de douane et moins de 10 % des exportations sont soumises à des droits de douane supérieurs à 5 %. Il s’agit principalement de vêtements, de textiles, de chaussures, et de certains produits pétrochimiques. (Certains produits de base continuent d’être soumis à des droits de douane si élevés qu’ils ne sont pas vendus aux États-Unis du tout.)
Le plus important pour le Canada est d’obtenir un accès sûr et stable au vaste et lucratif marché américain sans avoir à lutter constamment contre les droits compensateurs et antidumping imposés par les États-Unis, c’est-à-dire des tarifs douaniers imposés aux importations canadiennes jugées comme étant injustement subventionnées par le Canada ou dont le prix est fixé pour faire concurrence déloyale à l’industrie américaine (voir Protectionnisme). Le Canada veut qu’un accord soit conclu sur les subventions accordées à l’industrie canadienne qui seraient exemptées de droits compensateurs. Le Canada souhaite également que les marchés publics américains soient ouverts aux entreprises canadiennes et qu’un mécanisme de règlement des différends efficace et liant soit mis en place, et qu’il ne repose pas entièrement sur des décisions prises aux États-Unis.
Secteur de l’énergie du Canada
En revanche, les États-Unis veulent que tous les échanges de services et de propriétés intellectuelles soient inclus dans l’accord; que les possibilités d’investissement dans des industries canadiennes, plus particulièrement dans le secteur de l’énergie, soient libres et sans surveillance ni restrictions de la part du gouvernement fédéral; et que les politiques gouvernementales susceptibles de réduire les exportations américaines soient limitées.
De nombreux Canadiens espèrent qu’un accès plus sûr au marché américain puisse stimuler une série de mesures visant à améliorer l’efficacité des fabricants canadiens et réduire ainsi l’écart de productivité entre les entreprises américaines et canadiennes. Bien que la rationalisation de l’industrie manufacturière permette sans doute des économies d’échelle et que de nouvelles technologies soient rapidement adoptées au Canada, l’écart de productivité avec les États-Unis ne diminue pas.
Essor des exportations
Le processus de libéralisation accroit néanmoins considérablement les exportations canadiennes vers les États-Unis. Entre 1990 et 1995, les exportations augmentent de 12 % par an, un taux d’expansion presque deux fois supérieur à celui des exportations canadiennes vers le reste du monde. Les gains les plus importants sont enregistrés dans les industries où les droits de douane américains sont réduits le plus. Les exportations de produits non liés aux ressources augmentent deux fois plus rapidement que celles de produits de base, plus particulièrement les produits hautement technologiques comme l’équipement de bureau, les produits de télécommunications, les instruments de précision et une variété d’autres équipements et machines. Certains produits liés aux ressources, comme les papiers fins et les produits chimiques, connaissent également une croissance rapide. Par conséquent, la dépendance du Canada à l’égard des États-Unis comme marché d’exportation passe de 74,5 % en 1988 à 82 % en 1996. En 2023, les États-Unis demeurent le premier partenaire commercial en matière d’exportation du Canada, représentant 77 % du total des exportations.
Pour les industries de services, la suppression de certaines barrières tarifaires et la stimulation générale des entreprises canadiennes à adopter une perspective plus axée sur l’exportation grâce à l’accord de libre-échange entraine également une croissance rapide des exportations de services canadiens vers les États-Unis, particulièrement dans les services financiers, les services d’experts-conseils, les communications et la publicité.
L’ajout du Mexique à l’accord entre le Canada et les États-Unis n’a pas d’incidence significative pour les exportateurs canadiens puisque moins de la moitié de 1 % des ventes du Canada à l’étranger sont destinées au Mexique. Toutefois, en date de 2016, le Mexique représente le cinquième marché d’exportation du Canada.
Les importations canadiennes en provenance des États-Unis augmentent rapidement également, tant dans le domaine des produits de haute technologie que dans celui d’un certain nombre d’industries à forte intensité de main-d’œuvre, comme l’ameublement, les vêtements, les aliments transformés et les articles ménagers. En conséquence, la dépendance canadienne à l’égard des États-Unis comme source d’approvisionnement passe à 76 % en 1996, alors qu’elle est restée stable à 69 % pendant des décennies. Les États-Unis demeurent la principale source d’importation du Canada. Selon un communiqué de presse publié en 2025 par le ministère des Finances du Canada, le Canada est le plus grand marché d’exportation de 36 États américains.
Les importations en provenance du Mexique sont un peu plus importantes pour le Canada comparativement aux exportations vers ce pays. En 2016, le Mexique est la troisième source d’importations du Canada. Les principales marchandises importées sont concentrées dans un nombre relativement restreint de secteurs, comme les pièces d’automobiles, les machineries et équipements électriques et certains produits alimentaires.
Le Canada est exclu des marchés publics américains
Le Canada ne réussit pas à obtenir la libéralisation totale des marchés publics. Par contre, bien que les États-Unis refusent initialement d’inclure la propriété intellectuelle dans l’ALÉ, celle-ci est intégrée lors des négociations visant à faire adhérer le Mexique à l’accord. (Voir aussi Le Canada et l’ALÉNA.)
Aucun réel progrès n’est accompli dans la définition des subventions acceptables ou dans l’abrogation des lois relatives aux droits antidumping et compensateurs. Le Canada et les États-Unis conviennent de travailler davantage sur ces questions, mais rien n’est fait dans le cadre de l’ALÉ. Toutefois, lors des négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay (1986-1994) pour l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), des règles plus strictes sont développées au sujet du dumping et les subventions autorisées et non autorisées sont définies.
Un mécanisme de règlement des différends est mis en place afin que des comités binationaux examinent les conclusions des États-Unis et du Canada concernant le dumping ou les subventions, pour s’assurer que les lois de chaque pays soient correctement appliquées. Ce mécanisme fonctionne assez bien, à l’exception de certains cas comme le litige sur le bois d’œuvre et le blé dur où les États-Unis trouvent des moyens de contourner les règles du libre-échange afin de limiter les exportations canadiennes. (Contrairement au Canada où l’accord de libre-échange a effectivement préséance sur les autres lois canadiennes, aux États-Unis, d’autres lois ont préséance sur l’accord de libre-échange.)
Les règles canadiennes en matière d’investissements étrangers directs sont libéralisées, de sorte qu’il ne reste que peu de restrictions pour les entreprises américaines qui souhaitent s’établir au Canada. Ainsi, depuis l’accord, des milliers d’entreprises canadiennes supplémentaires sont rachetées par des investisseurs américains, et une grande partie des investissements directs canadiens sont réalisés aux États-Unis, ce qui contribue également à renforcer l’intégration des deux économies.
Développement des accords de libre-échange canadien
Perte de souveraineté?
Certains Canadiens croient qu’un accord global de libre-échange entre le Canada et les États-Unis pourrait éroder de manière irréversible la souveraineté économique, culturelle et politique canadienne. Certains soutiennent que cela ne se produit pas étant donné que le Canada continue de protéger ses industries culturelles et de poursuivre une politique étrangère indépendante vis-à-vis de pays comme Cuba. (Voir aussi Le Canada et l’ALÉNA; Accord Canada‒États-Unis‒Mexique [ACEUM].)
D’autres affirment que, même si le Canada s’est fortement mondialisé, le pays augmente sa concentration réelle en matière de commerce et d’investissements aux États-Unis. (Voir aussi Mondialisation.) Il a fallu plus de 30 ans au Marché commun européen initial pour passer d’une union douanière limitée à une intégration économique et politique presque complète sous la direction de l’Allemagne. Les détracteurs craignent qu’avec le temps, le Canada se retrouve dans une relation semblable avec les États-Unis, qui jouent un rôle beaucoup plus dominant en Amérique du Nord que celui que joue l’Allemagne en Europe.
Élargissement des réseaux de libre-échange
Le Canada élargit ses relations de libre-échange. La première de ces relations est l’accord de libre-échange bilatéral conclu avec le Chili en 1996. Essentiellement, le modèle de l’ALÉNA est utilisé pour la relation entre le Canada et le Chili. Le Canada négocie également un accord de libre-échange avec Israël en 1996 (accord que les États-Unis ont conclu en 1985). Toutefois, ces deux accords ont pour l’instant une valeur symbolique étant donné que les échanges commerciaux entre le Canada et ces deux pays ne représentent qu’environ 1/7e de 1 % du commerce total du pays.
Un accord de libre-échange plus important est conclu avec la Corée du Sud en mars 2014, le premier accord de ce type conclu par le Canada avec un pays de la région Asie-Pacifique. Connu sous le nom d’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC), cet accord avec la Corée du Sud et ses 50 millions d’habitants représente un marché important pour les exportateurs canadiens. L’accord devrait permettre au Canada d’avoir un accès plus vaste à l’Asie par l’intermédiaire des chaines d’approvisionnement de la Corée du Sud, plus particulièrement pour les producteurs agricoles, les produits de fruits de mer et les produits forestiers. L’accord est critiqué par Ford du Canada Ltée, qui déclare que les constructeurs automobiles sud-coréens bénéficieraient d’un accès moins coûteux au marché canadien, tout en étant injustement protégés en Corée du Sud par des barrières non tarifaires et la manipulation des devises.
Le Canada conclut également des accords de libre-échange avec le Costa Rica (2002), l’Association européenne de libre-échange (2009), le Pérou (2009), la Colombie (2011), la Jordanie (2012) et le Panama (2013). Il poursuit des négociations avec plus d’une douzaine de pays et de groupes de libre-échange en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes.
Mots clés
Libre-échange : Commerce dépourvu de barrières, comme les tarifs, les quotas ou les autres restrictions. Un gouvernement pratiquant le libre-échange s’abstient de créer des mesures désavantageuses pour les biens et les services importés.
Subvention : Montant d’argent accordé par des gouvernements à des entreprises ou à des organisations pour les aider à maintenir la compétitivité de leurs prix, à éviter de licencier des travailleurs ou à fournir un service d’intérêt public.
Tarif : Taxe imposée sur les biens et services, dans le but de rendre ces produits plus chers.

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom




_IMO_9785756,_Maasmond_pic.jpg)