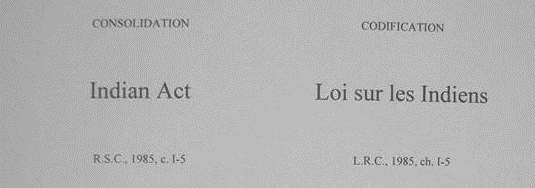En septembre 1850, les Anishinaabe (Ojibwés) des Grands Lacs supérieurs ont signé deux traités séparés mais interreliés : le traité Robinson-Supérieur et le traité Robinson-Huron. Ces accords permettaient à la Province du Canada (Canada‑Est et Canada-Ouest, les futurs Québec et Ontario) d’avoir accès aux rives nord des lacs Huron et Supérieur à des fins de colonisation et d’extraction minière. En échange, les peuples autochtones de la région ont obtenu la reconnaissance de leurs droits de chasse et de pêche, une rente (paiement annuel) et une réserve provenant de la cession des terres pour chaque communauté signataire. L’interprétation des traités Robinson a eu des répercussions juridiques et socioéconomiques sur les communautés autochtones et les communautés de colons, et ces traités ont créé des précédents pour les traités numérotés subséquents.
Contexte historique
Les revendications des Anishinaabe (Ojibwés) et la nécessité d’un traité commencent dans les années 1840 avec la découverte de gisements de cuivre et de fer sur la rive sud du lac Supérieur. Les spéculations concernant le potentiel de la rive nord augmentent également le désir d’un traité. Par conséquent, un agent des terres de la Couronne et des douanes, Joseph Wilson, est affecté à Sault Ste. Marie (maintenant l’Ontario). Peu après son arrivée en 1843, le chef Shingwaukonse informe Joseph Wilson des revendications et des droits des Anishinaabe. En 1845, la Province du Canada revendique l’autorité sur les rives nord des lacs Huron et Supérieur avant d’accorder un premier bail minier. Lorsqu’arrive l’année 1846, 64 permis d’exploitation sont déjà délivrés et l’arpentage de la rive nord est commencé, malgré l’absence de traités.
En 1846, alors qu’il arpente le terrain du village de Sault Ste. Marie, l’arpenteur du gouvernement, Alexander Vidal, est confronté par les chefs Nebenaigoching et Shingwaukonse. Ce dernier demande à Alexander Vidal de cesser ses travaux jusqu’à ce qu’un traité soit négocié. Le spéculateur minier et éditeur Georges Desbarats, qui détient des intérêts sur la rive nord du lac Huron, écrit au surintendant des Affaires indiennes en 1847 pour lui demander de régler les revendications des Anishinaabe (Ojibwés). Les chefs Shingwaukonse, Nebenaigoching et Menissinowenninne rendent alors visite au gouverneur général de l’époque, lord Elgin, à Montréal en 1849. Leur discours au gouverneur général est publié le 7 juillet 1849 dans le journal Montreal Gazette. On y lit que les Anishinaabe réclament la justice et demandent un traité tout en contestant les affirmations britanniques selon lesquelles les peuples autochtones sont traités avec plus de justice et de dignité que les Américains. Les Anishinaabe accusent également les Britanniques de voler leurs terres.
À la suite de cette visite, l’arpenteur Alexander Vidal et le capitaine T.G. Anderson, un ancien combattant de la guerre de 1812 et surintendant des Affaires indiennes, sont chargés de faire enquête sur les revendications des Anishinaabe. Ils commencent à Fort William le 24 septembre et ils se rendent à Sault Ste. Marie le 13 octobre. Comme c’est la fin de la saison, les commissaires n’arrivent à s’entretenir qu’avec quelques Anishinaabe. De nombreuses bandes se déplacent vers l’intérieur des terres pour l’hiver ou elles évitent les colons blancs pour échapper au choléra.
Lors de réunions qui ont lieu du 15 au 17 octobre à Sault Ste. Marie, les Anishinaabe réitèrent leurs revendications avec l’aide de leur avocat, Allan Macdonell. Les commissaires refusent de négocier ou de discuter avec l’avocat. D’après Allan Macdonell, avant de quitter la réunion en furie, Alexander Vidal fait la menace qu’il n’y aura pas de traité à moins que les Anishinaabe n’acceptent de négocier directement avec le gouvernement. Les commissaires quittent Sault Ste. Marie et ils se rendent ensuite à Penetanguishene, où ils rencontrent d’autres chefs assemblés le 3 novembre, avant de partir rédiger leurs rapports (qui sont terminés à Toronto en décembre 1849).
Indignés par le comportement des enquêteurs et l’inaction du gouvernement, les Anishinaabe s’emparent des installations de la Montreal Mining Company à Pointe aux Mines dans la baie Mica, sur le lac Supérieur. La mine est évacuée et des rumeurs se répandent au sujet une « guerre indienne » imminente. Le gouvernement riposte en dépêchant des troupes qui arrivent à Sault Ste. Marie le 2 décembre (voir Incident de Mica Bay). Les personnes jugées responsables de l’attaque, soit Shingwaukonse, Nebenaigoching et leurs alliés Wharton Metcalfe et Allan Macdonell, sont arrêtées et transportées à Toronto. Shingwaukonse et Nebenaigoching rentrent chez eux au début de 1850 pour attendre leur procès. Leurs accusations sont éventuellement suspendues en 1851, tout comme celles portées contre Allan Macdonell, tandis que Wharton Metcalfe s’évade de prison.

Négociations
Ces événements forcent le gouvernement du Canada-Ouest à négocier un traité. Le 11 janvier 1850, William Benjamin Robinson, ancien directeur de mine et frère du juge en chef, est nommé commissaire aux traités. Il arrive le 18 août 1850 à Sault Ste. Marie, où le gouverneur général lord Elgin le rejoint le 30 août. Après avoir avisé les chefs que William Benjamin Robinson a l’entière confiance de la Reine et qu’il doit négocier un traité équitable, lord Elgin s’en va. Des soldats sont présents tout au long des négociations et de la signature pour réprimer le « soulèvement indien ». Les négociations officielles durent plusieurs jours au début de septembre et elles se terminent le 9 septembre.
Les chefs du lac Huron, dirigés par Shingwaukonse, connaissent les termes des traités qui ont été conclus dans le Haut-Canada et aux États-Unis, et ils exigent une rente de 10 $ par personne et de vastes réserves. William Benjamin Robinson rejette ces « termes extravagants » et il décide que deux traités sont nécessaires. Il croit que les quatre chefs et les cinq principaux hommes du lac Supérieur, moins touchés par les intrusions coloniales, sont plus disposés à signer. Il prépare donc un traité le 6 septembre, qui est signé le lendemain. Il fait ensuite savoir à Shingwaukonse qu’il prépare un traité pour les chefs du lac Huron. Il menace également ceux qui n’ont pas signé qu’ils ne recevront ni protection ni compensation. Les chefs ont deux jours pour examiner leurs options. Shingwaukonse réitère ses demandes et exige de grandes concessions territoriales pour les Métis, mais William Benjamin Robinson refuse de céder. Le traité du lac Huron est ensuite signé.

Termes des traités
Le traité Robinson-Supérieur et le traité Robinson-Huron contiennent tous deux une liste des réserves, des droits de chasse et de pêche qui doivent durer jusqu’à ce que les terres soient utilisées pour la colonisation ou le développement, un paiement unique de 2000 £ et un paiement annuel de 500 £ et de 600 £, respectivement. Les deux traités contiennent également une clause d’indexation pour la rente, ce qui signifie que la Couronne l’augmentera à mesure que les revenus tirés des terres augmenteront.
En vertu de ces dispositions, les Anishinaabe (Ojibwés) cèdent la rive nord du lac Supérieur de la baie Batchewana jusqu’à la rivière Pigeon, à l’extrémité ouest du lac, et les terres de l’intérieur jusqu’à la ligne de partage des eaux. Ils cèdent également la rive nord du lac Huron de Penetanguishine à Sault Ste. Marie, et de là jusqu’à la baie Batchewanaung, sur la rive nord du lac Supérieur, y compris les îles de ces lacs faisant face à ces rives, et les terres de l’intérieur jusqu’à la ligne de partage des eaux.
Héritage
Les traités Robinson s’appuient sur les précédents américains qui servent de modèle pour la négociation et le cérémonial des futurs traités au Canada (voir Traités autochtones au Canada). La présence de soldats britanniques lors de la signature et lors de la visite du gouverneur général est adaptée et étendue aux traités numérotés (1871-1921). L’idée d’une rente annuelle et le maintien des droits de chasse et de pêche sur les terres de la Couronne viennent également de précédents américains et sont appliqués aux traités conclus suivant la Confédération.
La promesse de William Benjamin Robinson de régler les revendications des Métis n’est jamais tenue. Après de nombreuses contestations judiciaires, la Cour suprême du Canada reconnait les droits de chasse des Métis lors de l’affaire Powley en 2003.
La perte de territoires se poursuit tout au long des 19e et 20e siècles. Les signataires anishinaabe ne réalisent pas les avantages économiques que présente l’extraction des ressources. La mise en œuvre de la Loi sur les Indiens en 1876 et le Indian Lands Act de 1924 réduit l’efficacité des traités, ce qui a des répercussions négatives sur les Anishinaabe et sur leurs moyens de subsistance.
La clause d’indexation des rentes contenue dans les traités est activée en 1874, lorsque les paiements passent à quatre dollars par personne. Comme l’augmentation de la rente n’a jamais lieu depuis 1875, un recours judiciaire est intenté en 2019. Les signataires des traités réclament une augmentation de la rente et une indemnisation rétroactive de la part du gouvernement pour ne pas avoir augmenté la rente. En 2023, 21 Premières Nations signent un projet de règlement avec le Canada et l’Ontario d’une valeur totale de 10 milliards de dollars pour compenser les rentes en vertu du traité Robinson-Huron. En juillet 2024, la Cour suprême du Canada rend son jugement concernant l’affaire des rentes des traités Robinson-Huron et Robinson-Supérieur. Dans sa décision unanime, la Cour suprême déclare que les rentes de 4 $ par personne, inchangées depuis 1875, « ne peuvent être décrites que comme une parodie de la promesse de traité faite par la Couronne aux Anishinaabe de la région supérieure des Grands Lacs ». Elle déclare que la révision des rentes au fil du temps et leur augmentation, le cas échéant, sont nécessaires dans le cadre d’un concept juridique connu sous le nom d’honneur de la Couronne. Enfin, la Cour suprême ne se prononce pas sur le montant de l’indemnisation ni sur le montant des rentes de traité qui devraient être augmentées, déclarant plutôt que la Couronne doit négocier avec les plaignants de l’affaire Robinson-Supérieur pour déterminer l’indemnisation pour les violations passées.

 Partager sur Facebook
Partager sur Facebook Partager sur X
Partager sur X Partager par Email
Partager par Email Partager sur Google Classroom
Partager sur Google Classroom